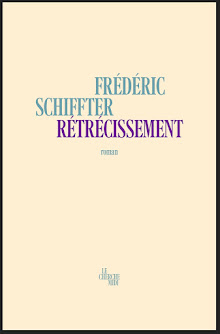Un éditorialiste médiatique, omniprésent à la télévision et sur les ondes, est le larbin d’un pouvoir, d’un parti, d’un groupe d’intérêts économiques ou financiers, et sa tâche est d’en faire la propagande. S’il n’apparaît pas avec un badge d’identification du think tank ou du lobby qui le paie, sa rhétorique le trahit. Mais comme très peu de gens ont l’oreille fine, nombre de gogos s’imaginent que l’éditorialiste médiatique est un esprit libre, mu par le pur mobile de faire valoir ses propres opinions, informées et avisées, et ils l’écoutent comme s’il s’agissait d’un intellectuel. Sans doute est-ce pourquoi les patrons des médias audio-visuels salarient depuis quelques temps des intellectuels — appelés aussi "philosophes" au mépris de toute précision sémantique — comme des éditorialistes permanents ou occasionnels. Jadis, Pierre Bourdieu brocardait le dévoiement de l’intellectuel qui désertait son bureau le temps d’une mode pour aller faire l’histrion dans le cirque de l’opinion journalistique. «Qui parle (dans les médias)?, demandait-il. Ce sont des sous-philosophes qui ont pour toute compétence de vagues lectures de vagues textes.[…]Ce sont des demi-savants pas très cultivés qui se font les défenseurs d’une culture qu’ils n’ont pas, pour marquer la différence d’avec ceux qui l’ont encore moins qu’eux». Bourdieu est mort trop tôt pour voir que, désormais, les intellectuels engagés le sont au sens où l’entend un patron quand il engage un employé. Tant et si bien que, comme cela devait se produire, les consommateurs de médias pensent aujourd’hui que l’activité consistant à pérorer sur l'actualité à la télévision et depuis les studios de radios en compagnie de vedettes attitrées de la jacasserie en continu, est, pour Michel Onfray, Luc Ferry, Alain Finkielkraut — avant que LCI ne le renvoie —, d’autres encore, la manière la plus démocratique d’exercer la pensée. Si téléspectateurs et auditeurs ne distinguent plus les éditorialistes des intellectuels, ce n’est pas tant parce que ces derniers exécutent avec zèle le rôle que leurs employeurs leur assignent, mais parce que l’éditorialisme représente à leurs yeux le pompon de leur carrière. D’aucuns, parmi eux, s’abaissent davantage en visant plus haut. Michel Onfray, par exemple, ayant rameuté autour de lui, par le biais de sa revue, Front populaire, une bande de plumitifs condamnés à le flatter, nourrit l’ambition de se présenter aux élections présidentielles — sauf si un autre nouveau philosophe, Éric Zemmour, s'y porte candidat. L’ex-hédoniste solaire passé au proudhonisme franchouillard, ne fera pas la sourde oreille si le pays, en quête de redressement, vient, dixit, le «plébisciter» sous ses fenêtres (clic). Dans mon dernier opus (clic), je désigne les intellectuels, quelle que soit la soupe idéologique qu’ils servent, sous le nom de philodoxes: les amis de l’opinion. Je cherche un autre terme qui, pour les caractériser, contiendrait l’idée d’une pauvre intelligence, pitoyable et ridicule. Éditorialistes fera l’affaire.
Affichage des articles dont le libellé est servitude intellectuelle. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est servitude intellectuelle. Afficher tous les articles
mardi 29 juin 2021
L' éditorialisme, pathologie sénile des intellectuels
Libellés :
Les brêles,
servitude intellectuelle
vendredi 27 octobre 2017
La République en laisse
L’autre soir, au restaurant,
Frédéric Pajak m’apprend qu’il avait décidé de quitter Paris en raison de
l’idolâtrie que cette ville voue à Emmanuel Macron. Je lui ai répondu que je ne
comprenais pas sa décision. De quel bonheur allait-il se priver! Ainsi moi qui
vis à Biarritz, lui ai-je dit, je me réjouis de l’amour du président qui y règne. Tout le monde, les jeunes, les vieux, surtout les
femmes, communient dans cette allégresse. Sans doute, ai-je concédé à Pajak, est-il
trop tôt pour mesurer les bienfaits sociaux de l’action de notre nouveau chef d'État, mais on ne peut nier qu’il œuvre d’ores et déjà au redressement de
l’âme des Français. Rien qu’en
prenant l’exemple de mes amis biarrots, ai-je dit à Pajak, tous fervents
partisans d’Emmanuel Macron, je puis affirmer que, depuis l’élection de ce dernier, leur esprit et leur sensibilité se sont aiguisés. Leur conversation
a gagné en qualité, leur personnalité en charme, leurs traits, même, en
beauté. Pareil perfectionnement de leur être a commencé, ai-je dit à Pajak, par
une révolution esthétique domestique. Tous mes amis, chez eux, dans leur entrée, leur salon,
leur chambre à coucher, ont accroché un portrait d’Emmanuel Macron qu’ils ont
découpé dans Paris Match, dans L’Obs ou dans Challenges. Parfois, il s’agit de photographies agrandies où il
pose en compagnie de son épouse Brigitte, souriante et bien habillée. Une amie, très
proche, très chère, conserve une image du couple présidentiel dans son
portefeuille. Or, ai-je dit à Pajak, c’est parce qu'ils vivent sous le regard à la fois
bienveillant et décidé de l’homme qui a fait barrage
au fascisme et au chavisme, que mes amis s’épanouissent. Et
c’est aussi pourquoi, confessai-je à Pajak, je me suis confectionné moi-même
des encadrements de portraits d’Emmanuel Macron que j’ai posés partout chez moi, y compris sur ma terrasse vue mer — afin de m’encourager à opérer en moi-même des réformes intellectuelles et
morales grâce auxquelles je ferai face aux défis de l’avenir. Pajak a écouté
mes paroles. Contre toute attente, il les a entendues. Il m’a promis une allégorie
à l’encre de chine représentant le président et son chien qu’il tient en laisse
guidant la France.
jeudi 21 juin 2012
Ne pas oublier Muray
«
[…]Notre monde est le premier à avoir inventé des instruments de persécution ou
de destruction sonores assez puissants pour qu'il ne soit même plus nécessaire
d'aller physiquement fracasser les vitres ou les portes des maisons dans
lesquelles se terrent ceux qui cherchent à s'exclure de lui, et sont donc ses
ennemis. A ce propos, je dois avouer mon étonnement de n'avoir nulle part
songé, en 1991, à outrager comme il se devait le plus galonné des
festivocrates, je veux parler de Jack Lang ; lequel ne se contente plus d'avoir
autrefois imposé ce viol protégé et moralisé qu'on appelle Fête de la Musique,
mais entend s'illustrer encore par de nouveaux forfaits, à commencer par la
greffe dans Paris de la Love Parade de Berlin. Je suis véritablement chagriné
de n'avoir pas alors fait la moindre allusion à ce dindon suréminent de la
farce festive, cette ganache dissertante pour Corso fleuri, ce Jocrisse du potlatch,
cette combinaison parfaite et tartuffière de l'escroquerie du Bien et des
méfaits de la Fête. L'oubli est réparé.[…] »
Philippe Muray
mercredi 15 février 2012
Aspect actuel et particulier du " señoritisme" (suite)
Jusqu’à ce que je regarde hier soir l’émission de Frédéric Taddéi, Alain Jugnon était pour moi un señorito de la contestation inconnu au bataillon. En cherchant dans Gougueul, j’ai découvert son sanchopancisme intellectuel à l’égard de Michel Onfray et son néo-debordisme. À ce sujet, voici une notice de présentation de son dernier ouvrage : Le Devenir Debord (Lignes).
« Le Devenir Debord, nous apprend Jugnon, n’est pas un livre de plus sur Debord, mais un livre avec Debord. Devenant Debord. Plus exactement, avec en soi un devenir Debord. Non pas par imitation. La pensée, c’est ce qui ne s’imite pas. Non pas donc pour devenir soi-même Debord après lui. Mais pour que tout devienne un peu de ce que Debord fut et pensa. Le redevienne. Le redevienne au point que lui-même revienne. »
Quelle cause sert un si redoutable libelle ? L’Homme. Car Jugnon part en guerre contre le nihilisme dont la politique sarkozienne est le nom, « nom transitoire d’une politique globale du capital, [qui] tient l’homme pour rien, le réduit à rien, au mieux le ridiculise, au pire le nie ».
C’est bien bon de la part de ce philosophe de vouloir sauver l’Homme, mais pourquoi cela doit-il passer, comme toujours chez les humanistes, par la négation du style ?
mercredi 3 août 2011
Sauve qui peut (les mots).
Certains jours, je me dis qu’il y a des mots sans défense qu’il faudrait protéger quand on les liquide en douce, et d’autres dont il faudrait laver l’honneur quand on en ternit le sens. Qui « on » ? Les journalistes, bien sûr. De la radio, de la tévé, ceux qui griffonnent dans les gazettes. Tous ces gens tellement chatouilleux sur leur déontologie, parlent et écrivent sans le souci de la précision élémentaire. Écoutez-les, lisez-les. Des professionnels du vague, de l’approximation, du cliché, du raccourci. Rien de plus logique : quand on fait métier d’informer le peuple, on s’exprime comme le peuple. Non pas le peuple tel que de Céline à Alfonse Boudard en passant par Jean Meckert, une littérature en a fait un sujet poétique ou romanesque, mais le peuple réel, c’est-à-dire ces foules de types et de bonnes femmes qui s’engouent pour les messes planétaires du foutebole, la fête de la musique, la réussite ou la déchéance des trèdeurs, la grossesse d’une starlette, la perversion sexuelle supposée d’un dirigeant mondial, le spectacle de milliers de cadavres gisant au sol après un raz-de-marée, l’éruption d’un volcan, une guerre néocoloniale, que sais-je encore — bref, ce peuple qui se goinfre des « infos » ou de l’« actu » en continu jusqu’à atteindre l’obésité mentale et dont le langage se réduit à un lexique de sportif professionnel, d'éducateur spécialisé, de commercial.
Or ce peuple, justement, sait-il encore faire la distinction entre les termes de «populaire » et de « public » ?
« Public » est un mot en sursis. C’était jadis un adjectif utilisé pour désigner une volonté politique d’administrer au sein d’une nation l’instruction, la santé, les transports, le courrier, le crédit et l’énergie. Les services publics, n’étaient pas et ne sont pas des services populaires. Ils évoquent une forme de souveraineté confiée aux citoyens les plus éclairés d’un État — lesquels n’ont cure de plaire au peuple, mais, prioritairement, et quitte à être impopulaires, d’œuvrer pour l’intérêt général. À l’inverse : quand les démagogues s’attaquent aux pouvoirs ou aux services publics, ils le font au nom d’aspirations populaires. Que demande le peuple? La baisse des impôts. La chasse aux Roms. La réduction du nombre de fonctionnaires. Un jour, qui sait, le rétablissement de la peine de mort pour les pédophiles et les tueurs de policiers. Et qu’on ne vienne pas nous objecter que les populistes seraient les faux amis du peuple — victime, quant à lui, selon ses vrais amis, de je ne sais quel « mensonge social ». La vérité est que le peuple fait ami-ami avec n’importe quel parti qu’il laisse parler en son nom pour peu qu’il trouve à traduire son mécontentement du moment — mécontentement faisant toujours suite à un enthousiasme imbécile. Quant au « mensonge social », Georges Darien, l’aristocrate de l’anarchie, dans Le Voleur, en avait dit l’essentiel : «Ses soi-disant victimes savent très bien à quoi s’en tenir et ne l’acceptent comme vérité que par couardise ou intérêt ».
Et puis, quoi ! Le mot « populaire » est laid. Le prononce-t-on en ma présence que, hors de l'oubli où la voix politique relègue aucun contour, se lève, peu ragoûtante, l’idée d’un vil potage. Prenez Michel Homay, par exemple, qui, fâché avec l’école publique, a laissé sa place de pion dans un lycée de bonnes sœurs pour une chaire d’un enseignement supérieur fictif. Qui peut croire que la philosophie en ressort grandie ? Son Université populaire est à la philosophie ce que la soupe du même nom est à la gastronomie.
« Philosophe », voilà un autre mot sali par la novlangue des media. Il n’y eut jamais qu’un seul philosophe, qui n’était ni professeur, ni chercheur, ni auteur de livres : Socrate. Or, qu’est-ce qu’un philosophe pour le peuple ? Un intellectuel qui occupe deux mi-temps. Un mi-temps consacré à enseigner et à publier, un autre mi-temps réservé au journal et au débat télévisés afin d’alerter l’opinion sur une cause morale à défendre, un engagement politique à suivre, ou sur la meilleure manière de vivre une vie d’homme, intérieure et citoyenne. Un communicant en idéologie pour une classe moyenne pauvrement lettrée. Un lampion qui se prend pour une Lumière du siècle. Qu’on lise Platon et Xénophon relatant le procès de Socrate — condamné à mort, je le rappelle, non par un régime tyrannique, mais par une démocratie. Imagine-t-on cet homme s’adresser au peuple sinon pour le bafouer ?
D’aucuns, parmi ceux qui lisent ces lignes, se rappellent peut-être la séquence de ce film, Palombella Rossa, où l'on voit le personnage de Nanni Moretti qui, hors de lui, gifle une petite journaliste inculte lui posant des questions farcies de mots passe-partout et de poncifs branchés: "Mais d'où sortez-vous ces expressions ? Mais comment parlez-vous? Comment parlez-vous? Les mots sont importants! Les mots sont importants!", lui rappelle-t-il en hurlant sa douleur. Ah ! Claquer le beignet à un Giesbert, à un Ruquier, à une Ariane Massenet ! Quel amoureux de la langue réagirait autrement? À moins que le découragement ne l’accable et qu’il se résigne à l’idée que Dieu ne donna le Verbe aux humains que pour les jeter dans le malentendu et la confusion, et que, à présent, les professionnels du verbiage ayant pris le pouvoir, Sa volonté est faite.
jeudi 27 janvier 2011
Interlude
Dans un opuscule intitulé En ce temps-là, Clément Rosset relate qu'il se rend un jour à une conférence de Jacques Lacan donnée dans le sein de l'École normale supérieure. La salle est à moitié pleine. On attend le conférencier qui officie là chaque semaine. "Il y avait quelque chose de bizarre dans le comportement de l'auditoire. Chacun était tranquillement occupé à lire son journal, à consulter ses notes, à essayer de résoudre un problème d'échecs ou de mots croisés. On avait l'impression que tout le monde s'attendait à quelque chose mais semblait en même temps résigné à ne s'attendre à rien." Le temps passe et, comme Lacan n'apparait toujours pas, C. Rosset demande à sa voisine en train de tricoter la raison de cette attente. "Comment ? Vous ne savez donc pas que Lacan ne viendra pas aujourd'hui ? Il est à l'étranger pour une quinzaine de jours." "Il se trouvait donc ici, conclut C. Rosset, des gens dont la soumission à l'égard de Lacan était telle qu'ils auraient cru gravement déroger en manquant une seule séance du maître — même s'il était connu et avéré que celui-ci en serait absent."
Libellés :
servitude intellectuelle
samedi 20 novembre 2010
lundi 1 novembre 2010
lundi 11 octobre 2010
dimanche 5 septembre 2010
Bonne nouvelle
 Une dépêche de ce jour signale que l'organisation E.T.A. a déclaré un cessez-le-feu — ce qui signifie, non pas que cette bande de têtes de mort racistes et totalitaires, qui ne vaincra ni ne convaincra jamais, a enfin compris que les Basques se foutaient de la cause basque, mais qu'elle est "militairement" défaite. Quantité de personnes sur qui pesait une menace d'assassinat — une fatwa patriotique — vont pouvoir souffler, notamment le philosophe Fernando Savater. Vive le Pays basque libéré de l'E.T.A.!
Une dépêche de ce jour signale que l'organisation E.T.A. a déclaré un cessez-le-feu — ce qui signifie, non pas que cette bande de têtes de mort racistes et totalitaires, qui ne vaincra ni ne convaincra jamais, a enfin compris que les Basques se foutaient de la cause basque, mais qu'elle est "militairement" défaite. Quantité de personnes sur qui pesait une menace d'assassinat — une fatwa patriotique — vont pouvoir souffler, notamment le philosophe Fernando Savater. Vive le Pays basque libéré de l'E.T.A.!
Libellés :
l'immonde,
ressentiment,
servitude intellectuelle
lundi 19 juillet 2010
Ce dont on ne peut parler, il faut le taire
Une idéologie est une éthique à l'usage des masses — qui en sont toujours friandes. Justice, Bien, Bonheur, Égalité, Race, Partage, Progrès, Fraternité, Communauté, etc., autant de foutaises portant majuscule qui les enfièvrent et les mènent à l'abattoir. C'est sans doute pourquoi, entendant son ami Bertrand Russel lui tenir un langage humaniste lénifiant, Ludwig Wittgenstein lui déclara : "La tyrannie ne provoque en moi aucune indignation." Et quand, un jour, Russel annonce à Wittgenstein qu'il compte créer une Organisation pour la Paix et la Liberté, ce dernier ricane. "Je suppose, dit alors Russel, que pour votre part vous préféreriez fonder une organisation en faveur de la guerre et de l'esclavage ?" Et Wittgenstein de rétorquer : "Oui ! Sans la moindre hésitation !"
Libellés :
amitié,
art du dédain,
bluff éthique,
domination,
l'immonde,
nihilisme,
philosophie,
servitude intellectuelle
jeudi 13 mai 2010
Michel Onfray et ses suiveurs ou du sanchopancisme intellectuel
Au § 34 du Crépuscule des idoles, Nietzsche décrit et fourre dans le même sac deux modèles d’hommes du ressentiment: le chrétien et l’anarchiste.
«Quand l’anarchiste, en tant que porte-parole des couches dégénérées de la société, exige avec une belle indignation le “Droit”, la “Justice”, “l’Égalité des droits”, il agit sous la pression de son inculture qui l’empêche de comprendre pourquoi il souffre au fond, et de quoi il est pauvre — c’est-à-dire de vie. […] S’il se sent mal, il faut que quelqu’un en soit la cause… Ainsi, sa “généreuse indignation” lui fait déjà du bien. Pour tous les pauvres types c'est toujours un réel plaisir de pouvoir proférer des imprécations — cela leur donne une petite ivresse de puissance. […]. Le chrétien et l’anarchiste sont tous deux des dégénérés. Quand le chrétien condamne, dénigre, salit le monde, on retrouve le même instinct qui pousse [l’anarchiste] à condamner, dénigrer, salir la société.»
Dans ce portrait de l’anarchiste, comment ne pas trouver un air de famille avec Michel Onfray? — non tant parce que ce dernier se désigne comme tel en toute occasion, mais parce qu’il oriente son enseignement, ses livres et sa posture médiatique dans le sens de l’imprécation contre des institutions et des personnes dénoncées comme des formes et des figures de pouvoirs oppressifs — lesquelles n’ont d’autre réalité que celle des monstrueux géants de Don Quichotte. À l’entendre ou à le lire, tout se passe comme si curés, fanatiques de tout poil et, à présent, thérapeutes freudiens, se liguaient pour forcer les braves gens du populo à aller à la messe, à se convertir à leur foi, à se faire racketter l’âme à un tarif prohibitif — alors que notre société consumériste, sans transcendance, érige l’hédonisme en devoir, encourage la liberté de conscience, exhorte à un joyeux œcuménisme, propose une foultitude de méthodes d’épanouissement personnel, consacre l’esthétisation du corps, en appelle à une sexualité polymorphe et heureuse.
Onfray a-t-il conscience de donner l’assaut à des moulins à vent quand, pour reprendre les termes de Nietzsche, il «condamne» l’idéal ascétique, «dénigre» les monothéismes, «salit» la mémoire de Freud ? Si la sincérité de son donquichottisme peut laisser perplexe, le sanchopancisme de ses admirateurs ne fait aucun mystère par la banalité même de ses ressorts psychiques. Cervantes et le Petit Robert nous renseignent sur ce sujet.
En cheminant le cul sur une mule au côté de Don Quichotte, non seulement Sancho Pança consent à être le suivant d’un illuminé, mais, surtout, un suiveur au sens donné par le Petit Robert : «celui qui s’inspire d’autrui, sans esprit critique, qui ne fait que suivre — un mouvement intellectuel, etc.». Pourquoi cet homme ignare, mais doué de bon sens et ne souffrant pas de visions, accepte d’être le compagnon, le serviteur et le défenseur d’un délirant, et ce, en toute connaissance de cause ? Pourquoi un tel suivisme que l’on retrouve chez les onfrayistes ? L'explication est simple. Concernant Sancho : quand bien même ce paysan juge Don Quichotte foutraque, les divagations de ce dernier flattent son amour-propre. À l’écoute de son maître qui se prend pour un chevalier, Sancho, oubliant sa monture, peut lui aussi se laisser aller à l’illusion de n’être pas un homme de peine, mais un écuyer. Grâce au baratin bien tourné de l'hidalgo le voilà comme ennobli. Concernant les onfrayistes, il en va de même. Affligés de carences livresques d’où procède leur complexe d'infériorité intellectuelle par rapport à des écrivains ou des universitaires, ils puisent dans les discours ou les textes de leur professeur —fort de vingt ans de carrière dans l’enseignement catholique — matière à une revanche narcissique. Séduits par sa rhétorique qui leur fait accroire que leur inculture générale n’est pas due à leur propre incurie mais à la confiscation du savoir par l’Élite parisienne et friquée — un géant très méchant ! —, ils épousent et servent la cause de leur champion et, ainsi, enfourchant la bourrique de bataille de la Contre-Philosophie, goûtent aux frissons d’une pensée héroïque. Un «anti-manuel de philosophie» au poing et voilà les dociles étudiants changés en esprits foutrement rebelles et volcaniques. Naturellement, pas plus que Sancho Pança ne s’intéresse aux romans de chevalerie — il ne sait pas lire —, les onfrayistes ne se passionnent vraiment pour la philosophie, la littérature ou les sciences humaines. Si tel était le cas, au lieu de se contenter d’une connaissance par ouï-dire, ils étudieraient eux-mêmes, et avec soin, les auteurs et les ouvrages que l’alter-universitaire subventionné exalte ou attaque. Non, ce qu'ils attendent d'Onfray c'est qu'il ait «tout lu» pour eux, qu’il fasse le tri dans les doctrines, établisse la morale qui sera bonne pour leur existence et, surtout, qu’il désigne à leur vindicte les coupables de leur condition de mal lotis de la culture (qu’ils demeurent, bien sûr, en raison même de leur « formation » à l’Université populaire) afin qu’ils puissent s’en revancher. Comment ? Par le seul moyen à la hauteur de leur impuissance : la plainte. Rien de bien surhumain ? Certes. Mais, après tout, comme le note Nietzsche en évoquant la révolte de l’anarchiste: «Le simple fait de se plaindre suffit à donner à la vie un charme qui la rend supportable».
Dans ce portrait de l’anarchiste, comment ne pas trouver un air de famille avec Michel Onfray? — non tant parce que ce dernier se désigne comme tel en toute occasion, mais parce qu’il oriente son enseignement, ses livres et sa posture médiatique dans le sens de l’imprécation contre des institutions et des personnes dénoncées comme des formes et des figures de pouvoirs oppressifs — lesquelles n’ont d’autre réalité que celle des monstrueux géants de Don Quichotte. À l’entendre ou à le lire, tout se passe comme si curés, fanatiques de tout poil et, à présent, thérapeutes freudiens, se liguaient pour forcer les braves gens du populo à aller à la messe, à se convertir à leur foi, à se faire racketter l’âme à un tarif prohibitif — alors que notre société consumériste, sans transcendance, érige l’hédonisme en devoir, encourage la liberté de conscience, exhorte à un joyeux œcuménisme, propose une foultitude de méthodes d’épanouissement personnel, consacre l’esthétisation du corps, en appelle à une sexualité polymorphe et heureuse.
Onfray a-t-il conscience de donner l’assaut à des moulins à vent quand, pour reprendre les termes de Nietzsche, il «condamne» l’idéal ascétique, «dénigre» les monothéismes, «salit» la mémoire de Freud ? Si la sincérité de son donquichottisme peut laisser perplexe, le sanchopancisme de ses admirateurs ne fait aucun mystère par la banalité même de ses ressorts psychiques. Cervantes et le Petit Robert nous renseignent sur ce sujet.
En cheminant le cul sur une mule au côté de Don Quichotte, non seulement Sancho Pança consent à être le suivant d’un illuminé, mais, surtout, un suiveur au sens donné par le Petit Robert : «celui qui s’inspire d’autrui, sans esprit critique, qui ne fait que suivre — un mouvement intellectuel, etc.». Pourquoi cet homme ignare, mais doué de bon sens et ne souffrant pas de visions, accepte d’être le compagnon, le serviteur et le défenseur d’un délirant, et ce, en toute connaissance de cause ? Pourquoi un tel suivisme que l’on retrouve chez les onfrayistes ? L'explication est simple. Concernant Sancho : quand bien même ce paysan juge Don Quichotte foutraque, les divagations de ce dernier flattent son amour-propre. À l’écoute de son maître qui se prend pour un chevalier, Sancho, oubliant sa monture, peut lui aussi se laisser aller à l’illusion de n’être pas un homme de peine, mais un écuyer. Grâce au baratin bien tourné de l'hidalgo le voilà comme ennobli. Concernant les onfrayistes, il en va de même. Affligés de carences livresques d’où procède leur complexe d'infériorité intellectuelle par rapport à des écrivains ou des universitaires, ils puisent dans les discours ou les textes de leur professeur —fort de vingt ans de carrière dans l’enseignement catholique — matière à une revanche narcissique. Séduits par sa rhétorique qui leur fait accroire que leur inculture générale n’est pas due à leur propre incurie mais à la confiscation du savoir par l’Élite parisienne et friquée — un géant très méchant ! —, ils épousent et servent la cause de leur champion et, ainsi, enfourchant la bourrique de bataille de la Contre-Philosophie, goûtent aux frissons d’une pensée héroïque. Un «anti-manuel de philosophie» au poing et voilà les dociles étudiants changés en esprits foutrement rebelles et volcaniques. Naturellement, pas plus que Sancho Pança ne s’intéresse aux romans de chevalerie — il ne sait pas lire —, les onfrayistes ne se passionnent vraiment pour la philosophie, la littérature ou les sciences humaines. Si tel était le cas, au lieu de se contenter d’une connaissance par ouï-dire, ils étudieraient eux-mêmes, et avec soin, les auteurs et les ouvrages que l’alter-universitaire subventionné exalte ou attaque. Non, ce qu'ils attendent d'Onfray c'est qu'il ait «tout lu» pour eux, qu’il fasse le tri dans les doctrines, établisse la morale qui sera bonne pour leur existence et, surtout, qu’il désigne à leur vindicte les coupables de leur condition de mal lotis de la culture (qu’ils demeurent, bien sûr, en raison même de leur « formation » à l’Université populaire) afin qu’ils puissent s’en revancher. Comment ? Par le seul moyen à la hauteur de leur impuissance : la plainte. Rien de bien surhumain ? Certes. Mais, après tout, comme le note Nietzsche en évoquant la révolte de l’anarchiste: «Le simple fait de se plaindre suffit à donner à la vie un charme qui la rend supportable».
Inscription à :
Articles (Atom)