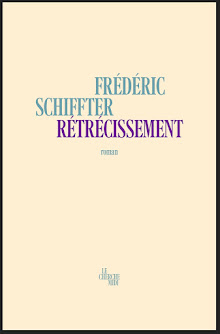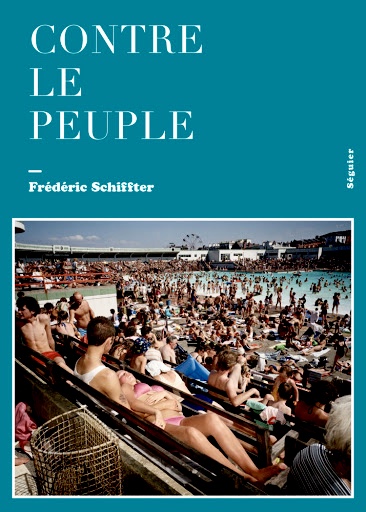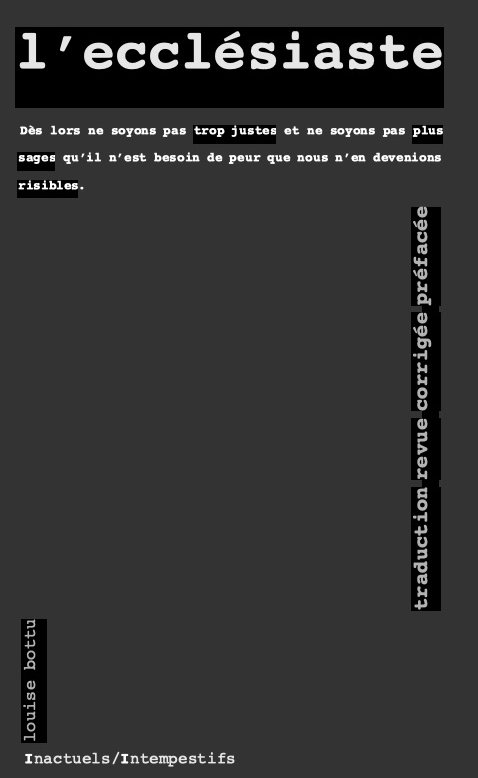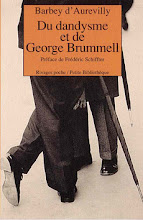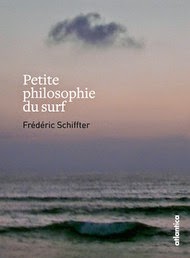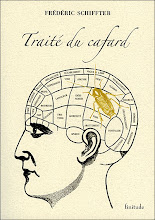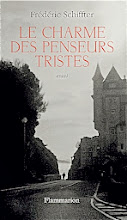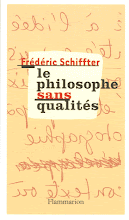«La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou inventer des concepts». J’ai toujours tenu ce propos de Gilles Deleuze pour une fadaise. Ses concepts de machines désirantes, de rhizomes, de plis, que sais-je, en sont les preuves. Jadis, j'avais beau essayer de les saisir, ils demeuraient dans le schprountz le plus total. Quand je demandais à un deleuzien qu’il me les explicitât, leur opacité augmentait. Mon désir de clarification passait à ses yeux pour un reste de pensée bourgeoise cartésienne. J’ignore si je suis un petit bourgeois cartésien, mais, une chose est sûre, je laisse à d’autres le snobisme de l’obscurité ou le plaisir d’être pris pour un couillon si répandu dans le monde universitaire ou para-universitaire. Pour moi un concept doit livrer un éclairage compréhensible sur un aspect de la réalité et de l’existence. Voilà pourquoi je fais mienne la formule de Ludwig Wittgenstein selon quoi la «philosophie est une activité consistant à élucider des concepts», c’est-à-dire, justement, à examiner leur capacité à rendre compte du réel ou de l’existence. Ce parti pris visant à interroger les notions générales afin d’en évaluer la netteté, était celui des «nominalistes». Wittgenstein avait un aïeul: Guillaume d’Occam, un moine tatillon sur les limites du langage, auquel Sean Connery prête ses traits — sous le nom de Guillaume de Baskerville — dans l’adaptation cinématographique du bouquin d’Umberto Eco: Le Nom de la rose. Les nominalistes rejettent la métaphysique en ce qu’elle est une pathologie du discours philosophique. Les mots, rappellent-ils, ne sont que des mots, ils désignent des choses ou des êtres singuliers; partant, en faire des idées universelles — comme l’Homme, la Liberté, le Bonheur, etc. — conduit la pensée à divaguer dans les cieux de l’abstraction. Dans un petit ouvrage de ma façon, je m'étais souvenu de l’enseignement nominaliste en désignant sous le terme de blabla toute philosophie qui s’enchante de ses propres effets verbeux et produit des mirages conceptuels. Le blabla deleuzien en est un exemple, comme, d’ailleurs, bien d’autres blablas de ce qu’on a appelé la French Theory. Toujours dans la continuité du nominalisme, j’ai, dans mon factum à paraître, interrogé la notion de «peuple» et rappelé que ce n’était qu’un mot non pas vide de sens, au contraire, mais vide de précision. Ne renvoyant à aucune réalité sociologique définie, il permet à ceux qui l’utilisent, surtout dans une acception méliorative, de le remplir du sens qui les arrange. Les blablateurs qui louent le peuple — politiciens et intellectuels de tout poil — s’appellent, familièrement des démagos. Les jobards qui leur accordent écoute et crédit, je les nomme démagogos. Le mot de peuple est, en soi, démagogique. Et, de même que La Fontaine montre dans sa fable comment un renard berne un volatile vulgaire et vaniteux, je dis de même dans mon opus que les démagos prospèrent sur la crédulité des démagogos tellement pressés de croire qu’ils seraient le Peuple, un sujet historique souffrant, pensant et voulant.
samedi 31 octobre 2020
Introduction à la lecture de Contre le Peuple
lundi 19 octobre 2020
vendredi 16 octobre 2020
Schopenhauer (suite) et la joie
Moi qui me rase à l’occasion de réjouissances collectives programmées et organisées à grand renfort de moyens de toutes sortes, et que je fuis systématiquement, je ne puis que souscrire à ce que le Patron, dans ses Aphorismes, écrit au sujet de la joie qui est censée s’y exprimer. «Les magnificences sont pour la plupart de pures apparences, comme des décors de théâtre. [Mais] l'essence de la chose manque. Ainsi les vaisseaux pavoisés et fleuris, les coups de canon, les illuminations, les timbales et les trompettes, les cris d'allégresse, etc., tout cela est l'enseigne, l'indication, l'hiéroglyphe de la joie; mais le plus souvent la joie n'y est pas: elle seule s'est excusée de venir à la fête.» Excellente formule. Et si vraie. Que rien ne soit plus sinistre qu’une foule qui exulte sur commande, seule une âme mélancolique, c’est-à-dire sensible à la joie réelle, peut le ressentir. Le paradoxe de ce que d’aucuns appellent le pessimisme de Schopenhauer, qui ne devrait résonner que des accents de la tristesse, est de reconnaître la présence de la joie dans le cours de la vie oscillant de la douleur à l’ennui. Mais ce qui fait de pareil pessimisme ni plus ni moins qu’une pensée lucide, c’est de rappeler la nature rare et éphémère de la joie, sa nature tragique, donc, là où Spinoza, Nietzsche ou, même, Clément Rosset, la substantialisent comme une force. Schopenhauer n'en parle pas comme un philosophe mais comme un écrivain — avec finesse et justesse. «Là où réellement elle se présente, elle arrive d'ordinaire sans se faire inviter ni annoncer, elle vient d'elle-même et sans façons, s'introduisant en silence, souvent pour les motifs les plus insignifiants et les plus futiles, dans les occasions les plus journalières, parfois même dans des circonstances qui ne sont rien moins que brillantes ou glorieuses. Comme l'or en Australie, elle se trouve éparpillée, çà et là, selon le caprice du hasard, sans règle ni loi, le plus souvent en poudre fine, très rarement en grosses masses. [Voilà pourquoi] dans toutes ces manifestations dont nous avons parlé, le seul but est de faire accroire aux gens que la joie est de la fête, d’en produire l'illusion […].» Schopenhauer n’a pas usurpé son titre de patron.
mardi 13 octobre 2020
Schopenhauer (suite) — Michel Houellebecq et le Patron
Dès les premières pages de En présence de Schopenhauer, Michel Houellebecq nous apprend qu’il a vingt-cinq ans quand il feuillette pour la première fois en bibliothèque un recueil d’aphorismes d’Arthur Schopenhauer. «En quelques minutes, tout a basculé», écrit-il. Le jeune homme, qui, en philosophie, «en était resté à Nietzsche», succombe soudain au charme toxique du maître de la négation. Quand il aura terminé de lire Le monde comme volonté et comme représentation, les idées du surhomme, de la mort de Dieu, de l’éternel retour deviendront à ses yeux des visions grotesques. Pour le poète et le futur romancier, Schopenhauer sera désormais le «Patron» — comme l’appelait Cioran.
Michel Houellebecq exprime sa gratitude envers Schopenhauer parce qu’il lui permettra de garder la tête froide à l’égard des utopies. Le propos du philosophe n'est pas de se plaindre de la mauvaiseté du monde, mais de rappeler qu’il est mu et déterminé par le vouloir-vivre, un élan universel, inépuisable, aveugle, absurde, et, dès lors, que rien n'y est fait pour notre bien. De notre premier souffle jusqu’au dernier, les maux nous affligent sans relâche. S’ils nous épargnent, nous nous savons menacés par le pire (pessimus), exposés aux maladies, aux cataclysmes naturels, aux guerres, à la pauvreté et à son cortège d’avilissements. Nous redoutons surtout nos semblables prompts à donner libre cours à leur violence physique ou à leur méchanceté morale. Même l’amour n’est qu’une duperie de la nature. C’est une illusion nourrie par un intérêt égoïste. La sexualité nous enchaîne à la procréation. Contre le pourboire de l’orgasme, l’espèce nous voue à sa perpétuation et au recommencement de nos souffrances.
On sait que, pénétré d’une pareille métaphysique, Michel Houellebecq excelle à décrire dans ses romans l’humiliation d’exister. Ses personnages vont d’espérances brisées en mécomptes cruels. La fatalité met dans leurs déboires toutes les douleurs de la tragédie, mais la dérision qui se mêle à leur torture réduit chacun d’eux au rôle de bouffon. Toutefois, on voit que dans les passages du Monde traduits ici, dans cet opuscule, par ses soins, Michel Houellebecq ne se borne pas aux considérations du philosophe sur les effets désastreux du vouloir-vivre chez les humains. On doit à Schopenhauer, dit-il, une théorie neuve de l’art. Chez un individu handicapé du vouloir-vivre, la représentation du monde peut donner lieu à une contemplation et, même, à une création esthétique. La nature produit en masse des individus actionnés par un ressort vital et les destine aux tâches socialement utiles. Accaparés par leur travail, leur carrière, leurs affaires, leur famille, leur engagement politique, leurs loisirs mêmes, les embesognés demeurent insensibles à la réalité qui les entoure et n’en ont que des idées communes. Ils ressemblent à ces hamsters qui tournent à toute vitesse dans leur petite roue et qui, s’ils étaient doués de conscience et de parole, auraient l’illusion qu’ils avancent dans la vie et l’arrogance d’affirmer qu’ils font bouger les choses. Or, c’est dans le petit nombre des êtres souffrant, au sens fort, d’une atrophie du désir compensée par une hypertrophie de la conscience que s’affirme la sensibilité artistique — ou encore, selon le mot de Schopenhauer, le génie. Trop faibles pour pédaler dans une petite roue, ces hamsters-là, losers de leur espèce, voués à la vita contemplativa, non seulement observent les autres s’activer dans leur machine, mais aussi leur cage et, à travers les barreaux, l’immense décor qui se tient au-delà. L’un d’eux maîtriserait-il, par exemple, un talent littéraire, il rendrait compte avec une économie de moyens, de manières, de formes, de ce qu’il perçoit, ressent, comprend et exposerait sans fard au regard de ses semblables les aspects de leur condition. Un roman serait la carte fidèle du territoire de l’existence.
Michel Houellebecq aura-t-il reconnu un reflet de lui-même dans ce portrait du génie selon Schopenhauer? Sans doute, bien que, suppose-t-il, il eût produit de meilleurs livres si la «pensée autour de lui avait été plus riche». Comment réagiront, alors, les contemplatifs sans œuvre ? Michel Houellebecq les console:« L’artiste est toujours quelqu’un qui pourrait aussi bien ne rien faire, se satisfaire de l’immersion dans le monde, et d’une vague rêverie associée».
F.S.
© Figaro Littéraire — 2018
jeudi 8 octobre 2020
Conférence à la médiathèque de Biarritz, samedi 10 octobre à 15h: La nature, mirage ou réalité ?
Désignée tantôt comme le grand Tout harmonieux qui nous environne ou nous enveloppe, tantôt comme la norme morale à laquelle doit se conformer notre vie, la nature demeure une notion qu’on interroge peu. Or les expressions «vivre dans la nature» et «vivre selon la nature», ne procèdent-elles pas de représentations illusoires des êtres de culture que sont les humains ?
vendredi 2 octobre 2020
Le monde comme bordel et comme tragi-comédie
Même si Schopenhauer n’a que sarcasmes pour les optimistes, on aura beau fouiller dans ses pages, jamais on ne trouvera qu’il définit sa pensée comme un pessimisme. Pareille qualification revient à ses lecteurs superficiels — c’est-à-dire les nietzchéens. Nietzsche, écrasé par la figure de Schopenhauer — comme par celle de Wagner —, a cherché à s’en émanciper en opposant les termes de «pensée tragique» et de «pensée pessimiste», la première étant la sienne, la seconde celle de son maître. Or, si on devait évoquer une belle analyse du pessimisme comme pensée tragique, on se reporterait à la Logique du pire de Clément Rosset dont le titre même est des plus évocateurs, puisque le «pire», en latin, se dit pessimus. Dans cet ouvrage, Rosset rappelle que le hasard étant la pire des causalités, logique productrice indifférente de désordres et d’ordres — donc de «bordel» comme il le dit ailleurs — aucune pensée du hasard ne peut donner lieu à une téléologie, comme, par exemple, l’avènement du surhumain, ou à une éthique, comme, par exemple, l’impératif catégorique suspendu au dogme de l’éternel retour du même. Le tragique nietzschéen n’est qu’un blabla, souvent grandiloquent, alors que le tragique schopenhauerien, souvent humoristique, fondant très justement dans une même acception la notion de fatalité et de hasard, excelle à exprimer la condition humaine. «La vie de chacun de nous, à l’embrasser dans son ensemble d’un coup d’œil, à n’en considérer que les traits marquants est une véritable tragédie. Et quand il faut, pas à pas, l’épuiser en détail, elle prend la tournure d’une comédie. Chaque jour apporte son travail, son souci; chaque instant sa duperie nouvelle; chaque semaine, son désir, sa crainte; chaque heure ses désappointements. Comme le hasard est là, toujours aux aguets, pour faire quelques malices, pures scènes comiques que tout cela. Mais les souhaits jamais exaucés, la peine toujours dépensée en vain, les espérances brisées par un destin pitoyable, les mécomptes cruels, qui composent la vie entière, la souffrance, qui va grandissant, et, à l’extrémité de tout, la mort, en voilà assez pour faire une tragédie. On dirait que la fatalité veut, dans notre existence, compléter la torture par la dérision; elle y met toutes les douleurs de la tragédie; mais pour ne pas nous laisser au moins la dignité du personnage tragique, elle nous réduit dans les détails de la vie au rôle du bouffon.» Il faudrait que j’examinasse la raison pourquoi d’aucuns, contre l’évidence, nient le tragique de Schopenhauer, alors qu’ils passent vite sur l’optimisme moral et historique de Nietzsche. La première idée qui me vient à l’esprit est qu’ils n’ont lu aucun de ces deux penseurs. Mais je m’interdis d’en être convaincu.