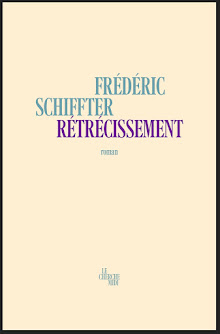Samedi, ma conférence bimestrielle était consacrée à la question des relations que la philosophie, les sciences et la religion, entretiennent entre elles. Devant un auditoire nombreux et attentif, j'ai développé l'idée que, dans la société du négoce, la figure de l'ingénieur avait effacé celle du philosophe et celle du prêtre. Pour le grand public, la philosophie s'apparente désormais à la psychologie, la religion à une morale écartelée entre tradition et modernité. Seules les sciences, par le truchement de vulgarisateurs, intéressent les esprits, un peu pour elles-mêmes, mais, surtout, pour les innovations technologiques qui en procèdent et vite mises sur le marché. Auguste Comte avait vu juste, ai-je dit. De l'«âge religieux» antique et médiéval, nous sommes passés à l'ère du calcul technoscientifique, en passant par l' «âge métaphysique» durant lequel la rationalité s'émancipait de la croyance. Tel est le progrès, ai-je poursuivi, à savoir la décomposition d'une ancienne forme de pensée, la philosophie, pensée purement interprétative, contemplative, méditative, aucunement tournée vers la «maîtrise et la possession de la nature» et moins encore désireuse de dominer les consciences — comme ce fut le dessein des cultes institués. Si ces derniers survivent, ai-je avancé, c'est parce qu'ils procurent encore le petit frisson du sacré dans le monde de la marchandise fétichisée. «Examinons le caddy culturel du consommateur», ai-je proposé, «on y trouve toutes sortes de spiritualités exotiques, de sagesses chimériques, de connaissances au rabais.» Maltraités, les gens en appellent à un utopique épanouissement personnel. Éprouvant l’absurdité de leur vie, les voilà vainement en quête de sens. Perdus dans un univers indifférent à leur présence, ils supplient les savants de leur prouver le contraire. Mais ils n’ont que leur smartphone pour leur tenir compagnie. Dieu n’est pas connecté. Ils n’entendent que l’écho de leur désarroi dans le vide de l’éther. «Est-ce là ma seule philosophie ? », ai-je dit. «Heureusement, oui !», ai-je répondu. Il était presque midi et demi. J’ai vu que cette causerie avait ouvert l’appétit des auditeurs. Nous nous sommes quittés bons amis.