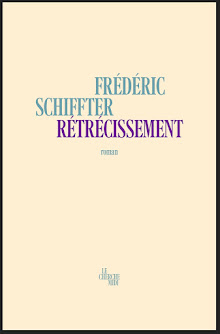Montaigne ne s’exprima en français qu’à l’âge de onze ans. Jusque là, son père, par amour des auteurs antiques, avait exigé que tout le monde en son château — famille, gouvernantes, précepteurs, domestiques — ne lui parlât qu’en latin. Est-ce par rejet de cette langue paternelle que Montaigne prit le parti de rédiger les Essais en français ? Peu importe. L’œuvre ainsi écrite, émaillée de citations de philosophes, de poètes, de dramaturges latins et italiens, s’offre à nous pareille à un splendide édifice renaissant.
Peut-on lire aujourd’hui les Essais avec leurs tournures archaïques et leur lexique parfois caduc ? Selon les jusqu’au-boutistes de la vulgarisation ayant l’oreille des éditeurs, les publier en leur «version originale» serait les confisquer à un large public aux seuls profit et plaisir d’une caste de lettrés. D’où l’entreprise de Gallimard d’en proposer une «traduction» en français moderne — celle d’André Lanly parue naguère chez Honoré Champion.
Dussé-je passer pour un snob, l’idée heurte mon sens esthétique. Montaigne se définit lui-même moins comme un écrivain que comme un «conférencier»: l’interlocuteur de son lecteur. D’ailleurs, il n’écrit pas, il «dicte à [sa] page». On l’entend parler. S’embarque-t-il dans un sujet ? Il s’en écarte, y revient, l’oublie, divague, rêvasse, mélange des anecdotes personnelles, intimes même, à des récits historiques, des mouvements d’humeurs à des réflexions fouillées. Or, par son style académique André Lanly neutralise le ton de conversation des Essais. Voilà pourquoi Claude Pinganaud, chez Arléa, en 1992, opte à mes yeux pour une meilleure formule : orthographe rajeunie, adjectifs et locutions adverbiales actualisés et mis entre crochets, vers et périodes latins traduits dans la continuité du texte. La lecture en devient aisée, sans que la sprezzatura de Montaigne, cette gracieuse désinvolture chère à Baldassar Castiglione et prisée par l’honnête homme, n’en soit altérée.
Que penser, dès lors, de la tâche de Pascal Hervieu consistant à traduire Montaigne du… japonais ? Si ce spécialiste des langues orientales montre tant de goût pour les travaux de publication aussi ardus que vains, qu’il s’attelle à la traduction en français courant des œuvres de Lacan, de Derrida ou encore de Levinas qui demeurent pour tout le monde, même pour leurs disciples, du chinois. À ces derniers, amateurs de «piperies», Montaigne aurait rappelé que l’obscurité est «une monnaie employée par les doctes, comme les joueurs de passe-passe, pour ne pas découvrir la vanité de leur art et dont l’humaine bêtise se paye aisément». Moderne ? D’actualité, plutôt. Là, nul besoin de sous-titres.