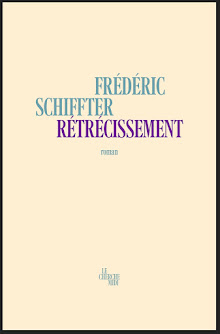À mesure que je traduisais Le Voluptueux inquiet (clic), je me disais que j’aurais pu l’écrire. J’avais le sentiment que Ménécée s’était livré à un plagiat par anticipation des écrits sceptiques à l’égard de la sagesse que je n’ai eu de cesse de publier pendant vingt-ans. Dans sa réponse à Épicure, il n’y a pas une seule idée que je ne puisse partager. Les hommes qui affirment croire dans les dieux sont plus à craindre que les dieux eux-mêmes. Nous ne sommes rien pour la mort et c’est pourquoi elle nous angoisse. Nous n’avons qu’un empire limité sur nos désirs. La nature est un non-être. Notre prudence reste impuissante à maîtriser le hasard. Conclusion: la tombe est le seul lieu de l’ataraxie. Dans sa lettre à Ménécée, Épicure concevait son éthique comme une médecine de l’âme constituée, on le sait, d’un quadruple remède. Au mot pharmakon — φάρμακον — les Grecs donnaient sans doute le sens de «remède», mais il signifiait aussi «poison». Ce n’est donc pas un mince mérite de Ménécée que de considérer la philosophie non comme une thérapeutique lénifiante mais comme une potion toxique. Un ouvrage philosophique digne de ce nom a vocation à empoisonner la pensée de son lecteur. On y verra une cruauté mentale. Assurément. Mais je rappellerai ce que disait Clément Rosset dans son Principe de cruauté: «Il n’y a probablement de pensée solide, quel qu’en soit le genre […], que dans le registre de l’impitoyable et du désespoir[…]».
Affichage des articles dont le libellé est bluff éthique. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est bluff éthique. Afficher tous les articles
jeudi 20 juin 2019
samedi 17 juin 2017
dimanche 19 août 2012
In girum imus nocte, etc.
La Ville - Gilbet Garcin
"Au cœur des jeux
de langage éthiques, revient l’expression: «La vie». Tous les
discours éthiques parlent de «la vie», comme un fait qui arrive
dans le «monde» — le réel. Or, «la» vie n’arrive pas.
Elle n’arriva ni n’arrivera jamais. Ce qui arrive, c’est non pas la vie
identique pour tous les vivants, mais, pour chacun d’entre eux, des formes de
vies différentes. La vie végétale n’est pas la vie animale. Autant de végétaux,
autant de formes de vies végétales. Autant d’animaux, autant de formes de vies
animales. De même concernant «la» vie humaine. Autant d’humains,
autant de formes de vies humaines. Sans doute certaines d’entre elles peuvent
se ranger dans des catégories génériques ou collectives; mais un humain
ressent clairement que rien ne ressemble moins à sa vie qu’une autre vie
d’humain. Quelle que soit la forme qu’elle prenne — en son cours elle en peut
prendre plusieurs —, la vie, pour lui, est toujours sa vie. Vivre, c’est se trouver, entre le moment de sa naissance et
celui de sa mort, dans une succession de circonstances particulières et
contingentes où, chaque fois, il se rend compte du caractère à la fois factuel,
aléatoire et, par là même, acosmique
de sa présence dans le réel. Rien de plus vain, dès lors, qu’il s’en remette
aux discours éthiques, puisque, visant à énoncer le sens de la vie, ou
encore la manière correcte de la
vivre, tous s’entendent à nier d’emblée la relativité circonstancielle de sa vie — vouée, de fait, à une totale
désorientation. Quel sens, quelle direction et quelle signification présupposer à sa vie quand vivre c’est être, du départ à l’arrivée, cerné par
la mort? Quand un voyageur égaré dans une ville inconnue, et démuni de
plan, demande à un autochtone le «meilleur chemin» pour regagner
son hôtel, ce dernier peut lui faire préciser ce qu’il entend par
«meilleur». Veut-il un parcours direct ou agréable? Est-il pressé? Dispose-t-il de temps? Anxieux, le voyageur choisira le chemin le plus
rapide. Décontracté, il s’engagera, pour flâner, dans les rues les plus
touristiques. Selon son état d’esprit, chaque option sera la
«meilleure». Dans les deux cas, il obtiendra de l’autochtone, si
celui-ci connaît bien sa ville, le renseignement souhaité pour parvenir à
son hôtel: un itinéraire, avec ses étapes et ses repères. Mais les
humains ne vivent pas dans une cité nommée «La Vie» — et nul prêcheur d'éthique n'en est un autochtone. Ce qu’ils
appellent vivre, c’est errer, circuler à l’aveugle en tout sens, au gré du
hasard, croisant, percutant ou ratant d’autres vies. Dans ce trafic des
destinées, nul humain ne peut indiquer à un autre le meilleur chemin pour s’en
extirper et atteindre à un séjour paisible et heureux. «Rien n’est plus
sûr pour les humains qui ont vu le jour que de mourir», dit Critias, le
cousin de Platon, une vielle connaissance de Socrate. «Et, ajoute-t-il, ceux
qui pensent qu’elle a une autre destination, ne peuvent que se perdre»."
In Le Bluff éthique
Libellés :
blabla,
bluff éthique,
philosophie en chambre
dimanche 29 janvier 2012
Le Surhomme, le Sage, le Saint, le Juste, fantasmes de nabots
« À quoi faire ces pointes élevées de la philosophie sur lesquelles aucun être humain ne se peut rasseoir et ces règles qui excèdent notre usage et notre force ? Je vois souvent qu’on nous propose des images de vie [des modèles de sagesses] lesquelles ni le proposant ni les auditeurs n’ont aucune espérance de suivre ni, qui plus est, envie.»
Montaigne, Les Essais
Livre III
§ 9
— De la vanité.
lundi 29 novembre 2010
Lapidaire
Un philosophe, à Cioran :
— On ne peut pas être tout à fait d'accord avec ce que vous dites.
Cioran, au philosophe :
— C'est toujours un peu le cas avec la vérité.
Libellés :
aphorisme,
bluff éthique,
cafard,
conversation,
cynisme,
nihilisme,
philosophie,
supériorité de l'ennui
lundi 8 novembre 2010
Sartre par Baudelaire
Portrait de la canaille littéraire.
Doctor Estaminetus Crapulosus Pédantissimus.
Son portrait fait à la manière de Praxitèle.
Sa pipe.
Ses opinions.
Son hégélianisme.
Sa crasse.
Ses idées en art.
Son fiel.
Sa jalousie.
Un joli tableau de la canaille moderne.
Doctor Estaminetus Crapulosus Pédantissimus.
Son portrait fait à la manière de Praxitèle.
Sa pipe.
Ses opinions.
Son hégélianisme.
Sa crasse.
Ses idées en art.
Son fiel.
Sa jalousie.
Un joli tableau de la canaille moderne.
Charles Baudelaire
Mon cœur mis à nu
Libellés :
art du dédain,
bluff éthique,
philosophie,
señoritisme,
supériorité de l'ennui
vendredi 29 octobre 2010
Plus de morts, moins d'ennemis

La lucidité consiste à se placer du point de vue de Dieu. C’est de là que Jacques Esprit examine le cœur des hommes. À l’évidence seul y palpite un amour-propre animé d’un féroce appétit de domination. Dès lors, toute vertu louée par la tradition philosophique n’est que fadaise, illusion, vent de bouche. L’amitié, célébrée par Cicéron et Montaigne? Il n’y a qu’aux morts que nous l’accordons car, vivants, nos semblables nous nuisent: «leur inquiétude trouble notre repos, leur malignité s’attache à notre réputation, ils traversent nos desseins par leur envie et leur jalousie, et ceux qui ont de bonnes qualités font remarquer nos défauts.»
Même si La fausseté des vertus humaines n’a pas la notoriété des Maximes de La Rochefoucauld, on y retrouve avec autant de plaisir ce que Pascal Quignard nomme « la manie noire dévastatrice » du jansénisme. Comme La Rochefoucauld, son complice, Jacques Esprit, passé des salons de la préciosité à Port-Royal, se divertit à faire la peau aux idéaux de grandeur et de sagesse. Mais chacun sa manière. Tandis que le vieux Frondeur, borgne et balafré, les pourfend d’un trait, l’ex-mondain, de ses délicates mains blanches, les dépèce avec méthode.
mercredi 6 octobre 2010
Derechef à propos de l'éthique (ou de l'effet du mot "sagesse" sur les esprits faibles)
Pour ne pas avoir à affronter la certitude qu'ils sont mortels, les hommes s'en remettent à la religion ou aux "sagesses". Grâce à telle ou telle ascèse, ils escomptent, selon la formule démagogique d'Épicure, "devenir des dieux pour eux-mêmes".
Quand il brocardait les fadaises métaphysiques et morales des philosophes, Montaigne se recommandait de l'à-quoi-bonisme de l'Ecclésiaste. J'ignore pourquoi il ne se recommanda jamais du je-m'en-foutisme de Lucien. Du "grand rieur de Samosate", comme l'appelait Renan, il suffirait de détourner son Philosophes à vendre et de remplacer les noms des auteurs antiques par ceux de nos auteurs contemporains, de pasticher le verbiage avec lequel ils expriment leurs doctrines, pour que le propos de Lucien fût parfaitement actualisé. "Je vends de la vie heureuse, réussie, vertueuse, de l'hédonisme solaire ! J'apprends à vivre et à mourir ! Qui veut acheter ces produits ? Qui veut être au-dessus de la vie humaine ? Profitez-en ! Sagesses en promotion!"
Libellés :
art du dédain,
bluff éthique,
inculture,
philosophie
jeudi 2 septembre 2010
Comment l'esprit vient aux jeunes filles

Les professeurs de philosophie se divisent en deux catégories. L’une motive les jeunes esprits en les entretenant dans l’espoir que leur vie s’accordera à leurs désirs réglés sur la raison ; l’autre les démoralise en leur rappelant que la raison est une chimère de philosophes et la vie un processus de démolition. Les bons professeurs se rangent dans la première catégorie — tous mes collègues ; les mauvais dans la seconde — moi.
Libellés :
adolescent,
aphorisme,
bluff éthique,
Jeunes filles,
philosophie,
présence des jolies,
séduction
vendredi 27 août 2010
Exercice spirituel
Chaque fois qu'il éprouvait la tentation du plaisir sexuel, dont il était esclave, Marc Aurèle se répétait que l'amour physique n'est qu'"un frottement de ventre avec éjaculation, dans un spasme, de liquide gluant". Du Houellebecq par anticipation.
Libellés :
aphorisme,
bluff éthique,
comédie des passions,
guerre des sexes
lundi 19 juillet 2010
Ce dont on ne peut parler, il faut le taire
Une idéologie est une éthique à l'usage des masses — qui en sont toujours friandes. Justice, Bien, Bonheur, Égalité, Race, Partage, Progrès, Fraternité, Communauté, etc., autant de foutaises portant majuscule qui les enfièvrent et les mènent à l'abattoir. C'est sans doute pourquoi, entendant son ami Bertrand Russel lui tenir un langage humaniste lénifiant, Ludwig Wittgenstein lui déclara : "La tyrannie ne provoque en moi aucune indignation." Et quand, un jour, Russel annonce à Wittgenstein qu'il compte créer une Organisation pour la Paix et la Liberté, ce dernier ricane. "Je suppose, dit alors Russel, que pour votre part vous préféreriez fonder une organisation en faveur de la guerre et de l'esclavage ?" Et Wittgenstein de rétorquer : "Oui ! Sans la moindre hésitation !"
Libellés :
amitié,
art du dédain,
bluff éthique,
domination,
l'immonde,
nihilisme,
philosophie,
servitude intellectuelle
jeudi 24 juin 2010
L'Etre et le Séant
Simone de Beauvoir (Chicago 1953)
"J'ajouterai qu'une bonne paire de fesses a plus de pouvoir en ce monde que toutes les élucubrations des philosophes."
L'Arétin
Libellés :
bluff éthique,
fesses,
philosophie
vendredi 14 mai 2010
Lire Montaigne en V.O.
Montaigne ne s’exprima en français qu’à l’âge de onze ans. Jusque là, son père, par amour des auteurs antiques, avait exigé que tout le monde en son château — famille, gouvernantes, précepteurs, domestiques — ne lui parlât qu’en latin. Est-ce par rejet de cette langue paternelle que Montaigne prit le parti de rédiger les Essais en français ? Peu importe. L’œuvre ainsi écrite, émaillée de citations de philosophes, de poètes, de dramaturges latins et italiens, s’offre à nous pareille à un splendide édifice renaissant.
Peut-on lire aujourd’hui les Essais avec leurs tournures archaïques et leur lexique parfois caduc ? Selon les jusqu’au-boutistes de la vulgarisation ayant l’oreille des éditeurs, les publier en leur «version originale» serait les confisquer à un large public aux seuls profit et plaisir d’une caste de lettrés. D’où l’entreprise de Gallimard d’en proposer une «traduction» en français moderne — celle d’André Lanly parue naguère chez Honoré Champion.
Dussé-je passer pour un snob, l’idée heurte mon sens esthétique. Montaigne se définit lui-même moins comme un écrivain que comme un «conférencier»: l’interlocuteur de son lecteur. D’ailleurs, il n’écrit pas, il «dicte à [sa] page». On l’entend parler. S’embarque-t-il dans un sujet ? Il s’en écarte, y revient, l’oublie, divague, rêvasse, mélange des anecdotes personnelles, intimes même, à des récits historiques, des mouvements d’humeurs à des réflexions fouillées. Or, par son style académique André Lanly neutralise le ton de conversation des Essais. Voilà pourquoi Claude Pinganaud, chez Arléa, en 1992, opte à mes yeux pour une meilleure formule : orthographe rajeunie, adjectifs et locutions adverbiales actualisés et mis entre crochets, vers et périodes latins traduits dans la continuité du texte. La lecture en devient aisée, sans que la sprezzatura de Montaigne, cette gracieuse désinvolture chère à Baldassar Castiglione et prisée par l’honnête homme, n’en soit altérée.
Que penser, dès lors, de la tâche de Pascal Hervieu consistant à traduire Montaigne du… japonais ? Si ce spécialiste des langues orientales montre tant de goût pour les travaux de publication aussi ardus que vains, qu’il s’attelle à la traduction en français courant des œuvres de Lacan, de Derrida ou encore de Levinas qui demeurent pour tout le monde, même pour leurs disciples, du chinois. À ces derniers, amateurs de «piperies», Montaigne aurait rappelé que l’obscurité est «une monnaie employée par les doctes, comme les joueurs de passe-passe, pour ne pas découvrir la vanité de leur art et dont l’humaine bêtise se paye aisément». Moderne ? D’actualité, plutôt. Là, nul besoin de sous-titres.
Libellés :
bluff éthique,
conversation,
manières,
supériorité de l'ennui
jeudi 13 mai 2010
Michel Onfray et ses suiveurs ou du sanchopancisme intellectuel
Au § 34 du Crépuscule des idoles, Nietzsche décrit et fourre dans le même sac deux modèles d’hommes du ressentiment: le chrétien et l’anarchiste.
«Quand l’anarchiste, en tant que porte-parole des couches dégénérées de la société, exige avec une belle indignation le “Droit”, la “Justice”, “l’Égalité des droits”, il agit sous la pression de son inculture qui l’empêche de comprendre pourquoi il souffre au fond, et de quoi il est pauvre — c’est-à-dire de vie. […] S’il se sent mal, il faut que quelqu’un en soit la cause… Ainsi, sa “généreuse indignation” lui fait déjà du bien. Pour tous les pauvres types c'est toujours un réel plaisir de pouvoir proférer des imprécations — cela leur donne une petite ivresse de puissance. […]. Le chrétien et l’anarchiste sont tous deux des dégénérés. Quand le chrétien condamne, dénigre, salit le monde, on retrouve le même instinct qui pousse [l’anarchiste] à condamner, dénigrer, salir la société.»
Dans ce portrait de l’anarchiste, comment ne pas trouver un air de famille avec Michel Onfray? — non tant parce que ce dernier se désigne comme tel en toute occasion, mais parce qu’il oriente son enseignement, ses livres et sa posture médiatique dans le sens de l’imprécation contre des institutions et des personnes dénoncées comme des formes et des figures de pouvoirs oppressifs — lesquelles n’ont d’autre réalité que celle des monstrueux géants de Don Quichotte. À l’entendre ou à le lire, tout se passe comme si curés, fanatiques de tout poil et, à présent, thérapeutes freudiens, se liguaient pour forcer les braves gens du populo à aller à la messe, à se convertir à leur foi, à se faire racketter l’âme à un tarif prohibitif — alors que notre société consumériste, sans transcendance, érige l’hédonisme en devoir, encourage la liberté de conscience, exhorte à un joyeux œcuménisme, propose une foultitude de méthodes d’épanouissement personnel, consacre l’esthétisation du corps, en appelle à une sexualité polymorphe et heureuse.
Onfray a-t-il conscience de donner l’assaut à des moulins à vent quand, pour reprendre les termes de Nietzsche, il «condamne» l’idéal ascétique, «dénigre» les monothéismes, «salit» la mémoire de Freud ? Si la sincérité de son donquichottisme peut laisser perplexe, le sanchopancisme de ses admirateurs ne fait aucun mystère par la banalité même de ses ressorts psychiques. Cervantes et le Petit Robert nous renseignent sur ce sujet.
En cheminant le cul sur une mule au côté de Don Quichotte, non seulement Sancho Pança consent à être le suivant d’un illuminé, mais, surtout, un suiveur au sens donné par le Petit Robert : «celui qui s’inspire d’autrui, sans esprit critique, qui ne fait que suivre — un mouvement intellectuel, etc.». Pourquoi cet homme ignare, mais doué de bon sens et ne souffrant pas de visions, accepte d’être le compagnon, le serviteur et le défenseur d’un délirant, et ce, en toute connaissance de cause ? Pourquoi un tel suivisme que l’on retrouve chez les onfrayistes ? L'explication est simple. Concernant Sancho : quand bien même ce paysan juge Don Quichotte foutraque, les divagations de ce dernier flattent son amour-propre. À l’écoute de son maître qui se prend pour un chevalier, Sancho, oubliant sa monture, peut lui aussi se laisser aller à l’illusion de n’être pas un homme de peine, mais un écuyer. Grâce au baratin bien tourné de l'hidalgo le voilà comme ennobli. Concernant les onfrayistes, il en va de même. Affligés de carences livresques d’où procède leur complexe d'infériorité intellectuelle par rapport à des écrivains ou des universitaires, ils puisent dans les discours ou les textes de leur professeur —fort de vingt ans de carrière dans l’enseignement catholique — matière à une revanche narcissique. Séduits par sa rhétorique qui leur fait accroire que leur inculture générale n’est pas due à leur propre incurie mais à la confiscation du savoir par l’Élite parisienne et friquée — un géant très méchant ! —, ils épousent et servent la cause de leur champion et, ainsi, enfourchant la bourrique de bataille de la Contre-Philosophie, goûtent aux frissons d’une pensée héroïque. Un «anti-manuel de philosophie» au poing et voilà les dociles étudiants changés en esprits foutrement rebelles et volcaniques. Naturellement, pas plus que Sancho Pança ne s’intéresse aux romans de chevalerie — il ne sait pas lire —, les onfrayistes ne se passionnent vraiment pour la philosophie, la littérature ou les sciences humaines. Si tel était le cas, au lieu de se contenter d’une connaissance par ouï-dire, ils étudieraient eux-mêmes, et avec soin, les auteurs et les ouvrages que l’alter-universitaire subventionné exalte ou attaque. Non, ce qu'ils attendent d'Onfray c'est qu'il ait «tout lu» pour eux, qu’il fasse le tri dans les doctrines, établisse la morale qui sera bonne pour leur existence et, surtout, qu’il désigne à leur vindicte les coupables de leur condition de mal lotis de la culture (qu’ils demeurent, bien sûr, en raison même de leur « formation » à l’Université populaire) afin qu’ils puissent s’en revancher. Comment ? Par le seul moyen à la hauteur de leur impuissance : la plainte. Rien de bien surhumain ? Certes. Mais, après tout, comme le note Nietzsche en évoquant la révolte de l’anarchiste: «Le simple fait de se plaindre suffit à donner à la vie un charme qui la rend supportable».
Dans ce portrait de l’anarchiste, comment ne pas trouver un air de famille avec Michel Onfray? — non tant parce que ce dernier se désigne comme tel en toute occasion, mais parce qu’il oriente son enseignement, ses livres et sa posture médiatique dans le sens de l’imprécation contre des institutions et des personnes dénoncées comme des formes et des figures de pouvoirs oppressifs — lesquelles n’ont d’autre réalité que celle des monstrueux géants de Don Quichotte. À l’entendre ou à le lire, tout se passe comme si curés, fanatiques de tout poil et, à présent, thérapeutes freudiens, se liguaient pour forcer les braves gens du populo à aller à la messe, à se convertir à leur foi, à se faire racketter l’âme à un tarif prohibitif — alors que notre société consumériste, sans transcendance, érige l’hédonisme en devoir, encourage la liberté de conscience, exhorte à un joyeux œcuménisme, propose une foultitude de méthodes d’épanouissement personnel, consacre l’esthétisation du corps, en appelle à une sexualité polymorphe et heureuse.
Onfray a-t-il conscience de donner l’assaut à des moulins à vent quand, pour reprendre les termes de Nietzsche, il «condamne» l’idéal ascétique, «dénigre» les monothéismes, «salit» la mémoire de Freud ? Si la sincérité de son donquichottisme peut laisser perplexe, le sanchopancisme de ses admirateurs ne fait aucun mystère par la banalité même de ses ressorts psychiques. Cervantes et le Petit Robert nous renseignent sur ce sujet.
En cheminant le cul sur une mule au côté de Don Quichotte, non seulement Sancho Pança consent à être le suivant d’un illuminé, mais, surtout, un suiveur au sens donné par le Petit Robert : «celui qui s’inspire d’autrui, sans esprit critique, qui ne fait que suivre — un mouvement intellectuel, etc.». Pourquoi cet homme ignare, mais doué de bon sens et ne souffrant pas de visions, accepte d’être le compagnon, le serviteur et le défenseur d’un délirant, et ce, en toute connaissance de cause ? Pourquoi un tel suivisme que l’on retrouve chez les onfrayistes ? L'explication est simple. Concernant Sancho : quand bien même ce paysan juge Don Quichotte foutraque, les divagations de ce dernier flattent son amour-propre. À l’écoute de son maître qui se prend pour un chevalier, Sancho, oubliant sa monture, peut lui aussi se laisser aller à l’illusion de n’être pas un homme de peine, mais un écuyer. Grâce au baratin bien tourné de l'hidalgo le voilà comme ennobli. Concernant les onfrayistes, il en va de même. Affligés de carences livresques d’où procède leur complexe d'infériorité intellectuelle par rapport à des écrivains ou des universitaires, ils puisent dans les discours ou les textes de leur professeur —fort de vingt ans de carrière dans l’enseignement catholique — matière à une revanche narcissique. Séduits par sa rhétorique qui leur fait accroire que leur inculture générale n’est pas due à leur propre incurie mais à la confiscation du savoir par l’Élite parisienne et friquée — un géant très méchant ! —, ils épousent et servent la cause de leur champion et, ainsi, enfourchant la bourrique de bataille de la Contre-Philosophie, goûtent aux frissons d’une pensée héroïque. Un «anti-manuel de philosophie» au poing et voilà les dociles étudiants changés en esprits foutrement rebelles et volcaniques. Naturellement, pas plus que Sancho Pança ne s’intéresse aux romans de chevalerie — il ne sait pas lire —, les onfrayistes ne se passionnent vraiment pour la philosophie, la littérature ou les sciences humaines. Si tel était le cas, au lieu de se contenter d’une connaissance par ouï-dire, ils étudieraient eux-mêmes, et avec soin, les auteurs et les ouvrages que l’alter-universitaire subventionné exalte ou attaque. Non, ce qu'ils attendent d'Onfray c'est qu'il ait «tout lu» pour eux, qu’il fasse le tri dans les doctrines, établisse la morale qui sera bonne pour leur existence et, surtout, qu’il désigne à leur vindicte les coupables de leur condition de mal lotis de la culture (qu’ils demeurent, bien sûr, en raison même de leur « formation » à l’Université populaire) afin qu’ils puissent s’en revancher. Comment ? Par le seul moyen à la hauteur de leur impuissance : la plainte. Rien de bien surhumain ? Certes. Mais, après tout, comme le note Nietzsche en évoquant la révolte de l’anarchiste: «Le simple fait de se plaindre suffit à donner à la vie un charme qui la rend supportable».
Inscription à :
Articles (Atom)