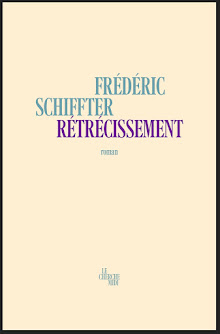La joie de Spinoza
en train de se relire
Je n’ai jamais rien retiré de la fréquentation des œuvres de Spinoza. Ni plaisir de lecture, ni profit pour ma jugeote. Passe encore qu’il donne à la nature le sobriquet de Dieu. Mais quand, après un enchaînement d’axiomes, de définitions, de scolies, dans lesquels il rappelle que nous sommes déterminés par nos affects, il annonce in fine que nous pouvons accéder à la sagesse, ce gros morceau intitulé l’Éthique me semble dur à avaler. Or, j’ai toujours été étonné que des amis philosophes puissent en faire leurs délices et en gober les incohérences. En fait de géomètre des passions, Spinoza reste pour moi un as de l’obscurité et de la confusion, surtout un platonicien qui s’ignore — vérité que ne veulent pas voir non plus les spinozistes. Car enfin, quelle est cette figure du sage qui apparaît au livre V de l’Éthique, sinon celle de l’Homme idéal ne pouvant loger ailleurs que dans le monde intelligible de Platon et, son amour intellectuel de Dieu, ni plus ni moins qu’une resucée de la vision bienheureuse du Vrai en soi. On sait que pareil phantasme d’un sage se baladant parmi les mortels sur le petit nuage du Souverain Bien, existait déjà chez Épicure. Hédoniste blasé, l’Ecclésiaste (clic) eût dit à ces deux professeurs de béatitude: «Ne soyez pas plus sages qu’il n’est besoin de peur que vous en deveniez risibles».