Atlantico : Vous publiez Contre le peuple aux éditions Séguier. Vous parvenez à « disséquer » et vous retracez dans votre essai les 1.001 visages du peuple et de cette notion, des origines antiques avec l’aube de la démocratie en Grèce jusqu’au mouvement récent des Giles jaunes. Pouvez-vous revenir sur votre vision de cette notion et sur votre contre-pensée de la notion de peuple, sur ce mot valise ?
De même que personne n’a jamais rencontré l’Homme, ou la Femme, mais des hommes et des femmes, de même jamais personne n’a eu affaire au Peuple, mais à des citoyens des deux sexes, de toutes conditions, de toutes origines, distincts, séparés, divisés en une multitude de groupes sociaux, aux intérêts antagonistes. N’importe quelle guerre civile montre que le mot de peuple ne signifie rien. Je sais bien que dans son sens courant ce mot suggère l’existence d’un être social collectif et uni, doté, comme une personne, d’une intelligence, d’une volonté, d’affects. C’est la conception héroïque qu’en avaient les idéologues révolutionnaires en 1789 et, au XIXe et XXe siècles, c’est celle qu’en avaient aussi les nationalistes, les anarchistes, les fascistes, les communistes, les gauchistes, les identitaires, et, maintenant, c’est celle que reprennent à leur compte les populistes de droite ou de gauche. Toutes ces obédiences politiques, fussent-elles ennemies, croient ou font croire à l’idée du peuple comme s’il s’agissait d’un sujet historique victime des turpitudes des puissants — nommés aussi «les élites» —, mais capable de se révolter, de porter un projet de société plus juste et d’y œuvrer. Or l’histoire montre que le « peuple », selon cette conception-là, n’existe pas. Au moment de la Révolution française le mot « peuple » englobait toutes les catégories sociales qui ne faisaient pas partie des ordres de la noblesse et du clergé. C’était le Tiers-État. Le «peuple» ne désignait donc pas seulement les crève-la-faim, les paysans et les gens des petits métiers, mais aussi les riches bourgeois, gros commerçants, banquiers, grands patrons de fabriques, ainsi que toute une petite bourgeoisie comprenant magistrats, avocats, ingénieurs, hommes de science et de lettres — à laquelle appartenaient, du reste, les députés de la Convention. Comme ces inégalités de conditions existent toujours, plus que jamais même, le mot peuple, censé évoquer une seule et même entité sociale, ne recouvre aucune réalité sociologique, et, quand on veut, comme les politiciens, les militants, les intellectuels de tous les bords, le réduire aux catégories des plus mal-lotis, c’est par clientélisme. Les Grecs de la démocratie athénienne appelaient démos l’ensemble des citoyens riches ou pauvres jouissant d’un égal droit de cité. Dans les démocraties modernes, l’équivalent du démos n’est, ni plus ni moins, que le corps électoral c’est-à-dire tous les citoyens ayant le droit de vote, du plus bas degré de l’échelle sociale au plus haut. En dehors de ce sens juridique et administratif le mot peuple, dans son imprécision, n’est qu’un élément de langage démagogique.
— La crise des Gilets jaunes a mis en lumière de nombreuses disparités au sein de la population et remis en lumière les travaux de Jérôme Fourquet sur l’archipel français et de Christophe Guilluy sur la France périphérique. Comment ne pas sombrer dans la démagogie ou dans le populisme pour la classe politique pour apporter des réponses concrètes aux difficultés des Français et une partie du peuple des Gilets jaunes?
La crise des Gilets jaunes a surtout réactualisé les observations d’Alexis de Tocqueville. En se modernisant, le capitalisme a effacé ce que Marx appelait le prolétariat et a créé une classe moyenne supérieure constituée de cadres diplômés et une classe moyenne inférieure constituée de petits employés. Tous travaillent, soumis, dans les multiples secteurs économiques. Mais, alors que les uns, aux salaires élevés, profitent de la «mondialisation heureuse», les autres, mal payés, qui pensaient en profiter, se sont retrouvés fragilisés, précarisés, suite aux délocalisations. C’est lors d’une casse sociale de grande ampleur que les citoyens de la classe moyenne inférieure comprennent que l’égalité des droits qu’ils partagent avec les citoyens de la classe moyenne supérieure ne donne jamais droit, justement, à une égalité de conditions. Ainsi, pour les Gilets jaunes, animés par cet affect que Tocqueville appelait la passion de l’égalité, l’injustice résidait dans cette disparité des jouissances. Leur envie, aurait dit encore Tocqueville, ne visait pas les hautes et puissantes instances capitalistes, mais les avantagés de la classe moyenne supérieure qu’incarnaient avec arrogance à leurs yeux, et à juste titre, les élus et les ministres de la macronie et le reste des professionnels de la politique. Les Gilets jaunes appartiennent au même corps électoral que les citoyens aisés des grandes villes où ils venaient manifester. Mais leur ressentiment leur a inspiré un retour au folklore égalitariste de 1789 en projetant sur Emmanuel Macron une haine antimonarchique. Entravés par cet imaginaire, ils ne pouvaient que tourner en rond chaque samedi en scandant comme un mantra: «RIC ! RIC !». Comme les sans-culottes, ils rejouèrent aussi les épisodes des querelles internes à leur mouvement — allant, comme leurs modèles, jusqu’à se menacer mutuellement de mort. Bien sûr, cette contestation a été une aubaine pour les démagogues de la petite bourgeoisie de tout poil, de la droite identitaire à la gauche radicale. Tous ont flatté la révolte de cette plebs humilis et, par là même, relancé la notion de peuple sur le marché de l’idéologie. Maintenant, vous me posez la question de savoir ce que peut faire la classe politique, sans sombrer dans la démagogie ou dans le populisme, pour apporter des réponses concrètes aux difficultés des Français et à une «partie du peuple des Gilets jaunes». N’ayant aucune estime pour la classe politique, considérant que les Gilets jaunes ne forment pas un peuple mais une catégorie de citoyens, et n’étant pas un de ces philosophes en quête de popularité plus connus sous le nom d’intellectuels, je n’ai aucune réponse concrète à apporter aux difficultés des Français. J’espère qu’ils ne m’en voudront pas.
— La pandémie du Covid-19 a mis en lumière un recul des libertés publiques liées aux mesures sanitaires. Comment expliquer l’absence de contestation réelle du peuple français par rapport à nos voisins européens (les manifestations et les débordements lors de ces rassemblements en Italie, en Allemagne et en Angleterre contre les mesures sanitaires ou le port du masque) ? La défiance pourrait-elle resurgir dans les urnes en 2022 en France?
Le peuple français ne peut rien contester parce que, encore une fois, c’est un fantôme sociologique et politique. En revanche, je vois que des catégories socio-professionnelles de citoyens regimbent contre les mesures sanitaires imposées par le gouvernement et que chacune, dans un esprit corporatiste, défend son bout de gras. Le tiroir-caisse des hôteliers, des restaurateurs, des bistrotiers, crie famine. Le personnel du secteur culturel se dit sacrifié. Mais il est vrai que par ailleurs les salariés, les chômeurs, les bénéficiaires d’assurances sociales, ne protestent pas contre ce qui ressemble à un retour de l’État-providence — quand celui-ci semble mettre au rancart, au moins provisoirement, les réformes de la retraite, du chômage, la sacro-sainte dette et injecte des centaines de millions d’euros dans l’économie et le maintien des aides sociales. En cela, les citoyens les plus fragiles ont obtenu plus de satisfactions grâce au virus que grâce aux longues et désespérées déambulations des Gilets jaunes. Les Français les plus démunis ne sont pas regardants sur le recul des libertés publiques tant que leur survie économique est garantie. Peut-être qu’en 2022 ils se souviendront qu’on peut très bien dépenser pour eux un « pognon de dingue ».
—Le peuple a-t-il encore un avenir dans les grandes démocraties occidentales et à l’échelle de la planète? La notion de peuple sera-t-elle la clé pour le monde d’après et lorsque la page du Covid-19 sera tournée ?
Comme l’a bien montré Machiavel, la politique est l’art de tenir en respect un ensemble d’humains par la force et la ruse afin d’obtenir une vie sociale relativement pacifiée. Or la démagogie est cette forme de ruse qui fait croire à des classes d’individus aux intérêts divergents qu’ils peuvent former un être commun, doté d’une âme, d’une identité, d’une volonté. Pareil mensonge étant fragile, tout l’art du prince, ou du candidat au pouvoir, est d’en consolider la crédibilité par des discours pompeux. La grandiloquence est cette rhétorique qui gonfle les baudruches pour leur donner l’apparence de statues majestueuses. La notion de « peuple » permet dès lors de diviser le monde politique en deux catégories : d’une part les démagos qui en exaltent la dimension lyrique car elle est une fiction utile à leurs desseins arrivistes, d’autre part les démagogos qui s’imaginent incarner ledit peuple. Comme le désir d’être trompé apporte moins d’inconfort que le désir d’être détrompé, autant dire que la baudruche est increvable.




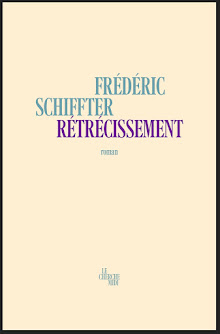
































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes et fielleux seront censurés.
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.