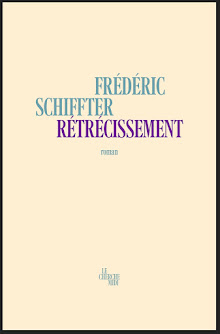René Descartes
Quand on me demande si je suis cartésien, je réponds par l’affirmative. Non tant parce que je me recommande de l’héritage rationaliste du philosophe, mais parce que je partage l’inclination qui fut longtemps la sienne pour les grasses matinées. Le Père Baillet, son biographe, écrit: «Descartes qui, à son réveil, trouvait toutes les forces de son esprit recueillies, et tous les sens rassis par le repos de la nuit, profitait de ces favorables conjonctures pour méditer. Cette pratique lui tourna tellement en habitude, qu’il s’en fit une manière d’étudier pour toute sa vie; et l’on peut dire que c’est aux matinées de son lit que nous sommes redevables de ce que son esprit a produit de plus important dans la philosophie et dans les mathématiques».
J’ai conscience que les essais que j’ai écrits dans mon lit n’auront pas la même postérité que le Discours de la Méthode ou Les Méditations métaphysiques. Mais, aussi modestes soient-ils, ils viendront témoigner que les grandes idées, contrairement à la vulgate nietzschéenne, ne viennent pas qu’en marchant. Tout cela pour dire que samedi prochain, le 17 novembre, à 15h, à la Médiathèque de Biarritz, je donnerai une conférence sur René Descartes. L’entrée sera libre.
J’ai conscience que les essais que j’ai écrits dans mon lit n’auront pas la même postérité que le Discours de la Méthode ou Les Méditations métaphysiques. Mais, aussi modestes soient-ils, ils viendront témoigner que les grandes idées, contrairement à la vulgate nietzschéenne, ne viennent pas qu’en marchant. Tout cela pour dire que samedi prochain, le 17 novembre, à 15h, à la Médiathèque de Biarritz, je donnerai une conférence sur René Descartes. L’entrée sera libre.