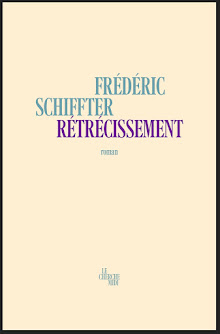Néo-Mexique 2013
Cette
fois-ci Clément Rosset est mort. Je dis cette fois-ci car il manqua se noyer en
2010 dans une crique majorquine. À nous, ses amis, qui lui demandions de
relater cette mésaventure qui lui coûta une vingtaine de jours de coma et de
soins intensifs, il répondait: «Je me suis endormi en nageant comme on s’endort
au volant». Après cet épisode, chaque fois que nous le voyions, nous songions
que nous avions eu de la chance de ne pas le perdre, même s’il nous répétait
qu’il eût volontiers porté plainte contre ses sauveteurs.
Je
vis pour la première fois Clément Rosset dans les années 1980, en regardant Droit de réponse, l’émission télévisée
de Michel Polac. Ce soir-là, Michel Polac avait réuni un plateau de philosophes
et d’écrivains. J’ai le souvenir d’une petite assemblée où, tandis que tous les
invités, impatients de pérorer, se coupaient mutuellement la parole, un seul
demeurait silencieux, les bras croisés sur la table, vêtu d’une chemise à
carreaux de bûcheron canadien, l’air mi-ennuyé mi-goguenard: c’était Clément
Rosset. Mon intuition me dit alors que ce philosophe qui s’abstenait de parler
avait forcément écrit de bons livres.
On
a coutume de dire que la philosophie commence avec l’étonnement. À juste titre.
Au sens premier, «étonnement» signifie «frappé par le tonnerre». Or à l’âge de
quinze ans, en vacances à Majorque, Clément Rosset subit une commotion
violente. Passant non loin d’un immeuble en construction, il voit un ouvrier
tomber d’un échafaudage. L’homme se tue net à ses pieds. L’horreur et la
frayeur qu’il ressent à cet instant font germer en lui une «logique du pire»
qui, son œuvre en témoigne, tournera à l’idée fixe: à l’image même de la
charpente métallique, les édifices métaphysiques et moraux, malgré la stabilité
apparente de leurs fondements et de leurs agencements, ne soutiennent rien et
n’offrent aux humains qu’une protection illusoire contre leur expérience du
hasard, du temps et de la mort.
Nietzsche
raconte qu’en mettant la main, dans une librairie, sur Le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer, il
éprouva sur le champ, à la lecture des premières pages, une griserie qui le
poussa à engloutir l’ouvrage d’une traite. Je fus en proie au même effet quand
je découvris Le réel et son double.
Le livre refermé, j’eus des secousses comme si j’avais avalé un de ces alcools
forts qui, selon une expression, vous remet «les yeux en face des trous». Sans
doute étais-je déjà lucide, mais, là, je voyais philosophiquement clair. Méfiant par instinct à l’égard des systèmes
de pensées idéalistes, je pouvais me recommander désormais de raisons plus
érudites. Nier le tragique de l’existence, pour lui substituer le double métaphysique de la «Nature», de
l’«Être », ou encore du «Monde», m’apparut comme une supercherie par quoi quantité
d’esprits — à commencer par les plus philosophes — se laissaient, en effet,
«doubler». Si bien que je ne dirais pas, comme Kant à propos de Hume, que
Clément Rosset m’éveilla d’un sommeil dogmatique, mais, plutôt, que ses livres
ont aggravé mon insomnie sceptique. Avant de connaître ce philosophe, je
pensais que l’existence était aléatoire, inconsistante et insignifiante;
depuis, c’est différent, j’en suis convaincu.
En
son temps, celui de l’optimisme hégélien triomphant, Schopenhauer endura l’insuccès
et l’isolement en raison de son pessimisme. La situation changea sitôt que des
romanciers découvrirent son œuvre — preuve même de la formule de Cioran selon
quoi les philosophes écrivent pour des professeurs, les penseurs pour des
écrivains. Si, aujourd’hui, Clément Rosset pâtit d’une relative méconnaissance,
il le doit à sa vision tragique et, surtout, à sa cécité éthique. Il est vrai
que, lorsqu’en ouverture de son Principe
de cruauté, il rappelle qu’il n’y a d’entreprise philosophique, littéraire ou
artistique solide que dans le registre de «l’impitoyable et du désespoir», il
n’arrange pas sa cote auprès de l’homme des causes justes. Ce dernier, toujours
en quête de motifs pour s’engager, déplore de ne trouver chez Clément Rosset
aucune trace d’indignation, aucun désir de protester
ou de «déranger l’ordre établi». L’insensibilité morale du philosophe de la
cruauté le heurte. Car outre Voltaire, bien sûr, ou Sartre, ou Foucault, la
référence de l’homme des causes justes reste Camus et sa formule: «Je me
révolte, donc je suis». Quand il défile ou signe des pétitions, il pense même:
«Je me révolte, donc je suis bon». Qu’un philosophe, dès lors, fasse silence
sur la question morale et politique du «mal» et s’abstienne de défendre
victimes et offensés — comme c’est le cas de Clément Rosset —, il le suspectera
d’être du côté des oppresseurs. Il le prendra à partie: «Toi le logicien du
pire qui jamais ne s’indigne devant l’horreur et l’injustice, n’es-tu pas avant
tout un être humain?». Et de lui
brandir sous le nez ce que Clément Rosset appelle lui-même le «syllogisme du
bourreau»: «Tu approuves la réalité. Or tu n’ignores pas que dans la réalité
sévissent des bourreaux. Donc tu approuves les bourreaux!» Argument haineux du Juste
auquel le logicien du pire répond en en modifiant la conclusion: «J’approuve la
réalité, en effet, même s’il y a des bourreaux; mais je note que malgré votre
indignation, ils ne vous empêchent pas vraiment de vivre» — réponse qui,
naturellement, aggrave son cas.
Dans
un de ses ouvrages, Clément Rosset consacre une trentaine de pages bien serrées
à la joie qu’il nomme la force majeure.
Si, selon lui, les humains persévèrent dans l’existence, alors que, s’ils
écoutaient la raison, ils se supprimeraient toute affaire cessante, c’est parce
que la joie de vivre les transporte bon gré mal gré, au hasard et dans le flux
du temps, insouciants de la destination fatale. Ainsi, non seulement la joie
n’offre aucun sens à leur vie — comme le dit Mozart dans une lettre à son père,
«mourir est le seul but» —, mais elle s’impose à eux comme un élan
déraisonnable — un folie, même. Quant à ceux qui en sont les plus pénétrés, les
voilà préservés de ce poison psychique que Nietzsche avait identifié sous le
terme de «moraline» — l’expérience montrant en effet que les joyeux ne nuisent
à personne et n’ont pas la lubie d’améliorer les hommes.
Quelques années après l’émission de Michel Polac, j’eus la
chance de connaître personnellement Clément Rosset dont j’avais lu avec un vif
plaisir littéraire tous les essais — notamment ceux, lumineux, consacrés à
Schopenhauer. Je tins ainsi l’occasion de lui manifester amicalement des
réserves au sujet de sa philosophie de la joie qui faisait à mes yeux un
mauvais parti à la mélancolie. À l’origine de ce mauvais parti, je ne voyais
qu’un mauvais procès reposant sur ce seul attendu: la joie est une passion
tragique, la mélancolie une passion romantique — une langueur d’esthète. Tandis
que la première dirait «oui» à l’existence réelle en ce qu’elle a de plus inacceptable,
l’autre lui dirait «non» pour la même raison et ne donnerait son assentiment
qu’à une existence rêvée, ou subvertie, répondant au signalement de l’Idéal.
Or, disais-je à mon ami dont je craignais les piques, sauf à en accréditer une
image simpliste, le romantisme ne se propose-t-il pas de décrire les offenses
du temps et les offensives de la mort et d’exprimer toutes les nuances du sentiment
de cette tragédie intime? La mélancolie modère sans doute l’enthousiasme
d’exister, mais, au contraire de la joie, elle ne paralyse pas le désir
d’écrire, de peindre, de composer et autres exercices de lucidité. La
jubilation interdit la conscience de soi sous peine de se volatiliser aussitôt.
Le mélancolique contemple l’inconsistance des choses de sa vie et, mieux que
l’homme joyeux, il sait que l’éternité de chaque instant est menacée — savoir
ombré de tristesse, peut-être, mais inséparable d’une volupté dont il refuse de
guérir. Cerné par la vulgarité tapageuse des joyeux drilles et des fêtards,
pourquoi fuirait-il hors de l’asile poétique qu’il porte en lui?
Clément
Rosset affirmait aussi que «tout grand écrivain sait faire oublier son moi,
quel que soit le genre littéraire qu’il aborde». Là encore, je m’étais permis
de lui objecter qu’à ce compte, il faudrait rayer de la littérature les
journaux intimes, les mémoires, les confessions. «Je suis moi-même la matière
de mon livre», dit Montaigne en ouverture des Essais. Dès lors que la philosophie est un genre littéraire et
qu’un philosophe prétend penser la vie — qui n’est autre que sa vie, unique et singulière, son
«idiotie» disait Clément Rosset —, l’impudeur me paraît de mise. Sans doute y
a-t-il impudeur et impudeur. Sans doute convient-il de distinguer l’ego qui a
besoin de parler de lui — et qui se
déballe sans égard pour la pensée et le style —, et l’égotiste qui s’évertue à écrire sur soi — en conférant une tenue
littéraire et philosophique à ce qui demeure, de toute façon, l’inconvenance
d’exister. Aussi me suis-je réjoui que Clément Rosset, faisant entorse à son
dogme, ait consigné dans Route de nuit les
épisodes cliniques d’une dépression sévère et tenace. Je me souviens qu’après
sa sortie des ténèbres et avant de le rencontrer pour la première fois à la
table d’une brasserie parisienne où il fit un sort à tous les plats comme aux
bouteilles de vin, j’avais posté à Clément Rosset ce mot que Beckett
télégraphia un jour à Cioran: «Je me sens à l’abri dans vos ruines».