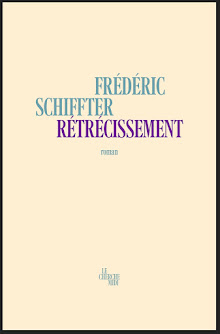vendredi 27 avril 2012
samedi 7 avril 2012
mardi 3 avril 2012
Prier dans le bain
Dessin de Unlucky
«La lecture matinale du journal est une sorte de prière réaliste», disait Hegel. Je ne lis pas les journaux, mais j’écoute la radio pendant que je prends mon bain. La prière dure une bonne demi-heure.
Dans les discours relatifs à la crise et aux dettes contractées par les Etats européens, j’ai beau tendre l’oreille, mais je n’entends jamais évoquer l’A.G.C.S.
Décidé par les instances supranationales de l’O.M.C. en 1995, cet Accord Général pour le Commerce de Services — le G. A. T. S. en anglais — prévoyait pour la fin de la première décennie des années 2000 la privatisation des services publics : la santé, l’éducation, les transports, le courrier, l’énergie, le crédit — ce qu’il en reste. L’idée était que tout Etat européen devait s’obliger à des économies budgétaires sévères afin que ces secteurs, de plus en plus asphyxiés et, par là, affligés de dysfonctionnements, n’aient plus d’autre destinée que d’être vendus à l’encan, dans les bourses, aux groupes multinationaux les plus offrants. Concomitamment, la construction de l’union européenne, en accélérant la dérèglementation des législations nationales, répondrait à cette orientation. Comme les structures étatiques résistent de par leur ancrage historique, le programme de l’A.G.C.S. a pris du retard. Or, sans être grand clerc en matière d’économie, je me dis que la crise, qui fait entonner plus que jamais aux dirigeants le refrain de la rigueur, représente une aubaine pour accélérer ce processus de démolition des Etats-nations, démolition confiée aux responsables de ces Etats eux-mêmes, comme on le voit avec la Grèce, ce laboratoire où les puissances du marché expérimentent un type d’Etat sans souveraineté et dont la plupart des infrastructures sont achetées par des fonds étrangers — aujourd’hui chinois, demain qataris, après-demain indiens ou brésiliens.
Comme le tour de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal ne saurait tarder, pour les expérimentateurs du marché, l’aspect le plus intéressant de l’épreuve est de voir quelle résistance les Grecs, humiliés à la face du monde et soumis à la saignée, vont opposer. Tels des entomologistes avec des bestioles placées sous verre, ils observent la capacité des fonctionnaires, des petits employés, des retraités, des étudiants, etc., à se mobiliser et à organiser leurs faibles forces pour contrecarrer l’agression mortelle. Pour l’heure, ils assistent, comme prévu, à une agonie des plus prometteuses. Les journées et les nuits d’émeutes qui se succèdent ajoutent à l’épuisement de devoir vivre dans le dénuement. Elles deviennent plus rares. Le découragement gagne les gens. Les Grecs se rendent compte qu’ils ne forment pas un peuple mais des catégories hétérogènes que le parti communiste disloqué et l’église orthodoxe essoufflée ont cessé d’unifier. Les télévisions étrangères présentes sont là pour en témoigner et, aussi, transmettre au reste des populations européennes l’idée que si l’indignation est légitime, la résignation l’emporte en sagesse tant et si bien qu’il convient d’opter immédiatement pour celle-ci sans céder à celle-là.
Libellés :
grandeur de l'humain
mercredi 21 mars 2012
Todestrieb
Salvador Dalí-Portrait de Sigmund Freud
« […] Freud fut pour moi une lecture de lycée et des premières années d’université durant lesquelles je dévorais aussi Zweig, Schnitzler, Roth, et collectionnais les livres d’art consacrés à Schiele, Kokoschka, Klimt. Alors que je cultivais une nostalgie sécessionniste fin de siècle, le psychanalyste autrichien en vogue dans les milieux estudiantins de la gauche révolutionnaire n’était pas Freud mais Wilhelm Reich, inventeur halluciné d’une libido cosmique — «découverte» dont il essaya, à la fin de sa vie, dans son exil américain, de tirer des applications techniques: une machine à guérir le cancer et un «chasseur de nuages». Avant de s’abîmer dans la démence et de finir en prison pour pratique illégale de la médecine, Reich, dans les années trente, fonda le freudo-marxisme en introduisant la doctrine de la lutte des classes dans la théorie de la répression des instincts. […] Pour Reich et ses épigones, le communisme serait les soviets plus l’orgone.
En réalité, la raison pour laquelle les gauchistes des années soixante-dix optaient pour Reich contre Freud [était qu’] ils ne pardonnaient pas à l’auteur de Malaise dans la civilisation d’avoir écrit que l’humain n’était pas un animal débonnaire au «cœur assoiffé d’amour», qui ne fait que se défendre quand on l’attaque, mais un prédateur pour les autres individus de son espèce, «tenté de satisfaire son besoin d’agression à leurs dépens, d’exploiter leur travail sans dédommagement, de les utiliser sexuellement sans leur consentement, de s’emparer de leurs biens, de les humilier, de leur infliger des peines, de les martyriser et de les tuer». Ces gens nés au milieu du vingtième siècle parmi les décombres encore fumants d’une Europe dévastée par une deuxième guerre mondiale et des génocides, contemporains d’une foultitude de conflits sanglants en Asie, en Afrique et en Amérique latine, incriminaient Freud pour son pessimisme anthropologique. La pulsion de mort ? Un préjugé « bourgeois », irrationnel. Car les humains, selon les gauchistes, ne furent pas violents à l’origine de leur histoire, ils le devinrent. Et s’ils le devinrent, ce fut à cause de l’instauration de la propriété privée, de la nécessité de la protéger manu militari puis, plus tard, à cause de la généralisation de l’esclavage, du mode d’échange marchand et de l’Etat, et, plus tard encore, à cause de l’apparition du capital et du travail salarié. À travers leur phraséologie marxisante, les reichiens lançaient en réalité contre Freud les mêmes accusations que Rousseau adressait à Hobbes.
[…] À maintes reprises, Freud, dans Malaise dans la civilisation, paie sa dette à Hobbes qui écrivait quant à lui dans son Léviathan : «Nous trouvons dans la nature humaine trois causes principales de discorde : primo, la Compétition ; secundo, la Défiance ; tertio, la Gloire. La première pousse les hommes à s’agresser en vue du gain, la deuxième en vue de la sécurité, et la troisième en vue de la réputation». Pour Freud, c’est le désir de gloire qui constitue la principale cause du malheur des humains — désir de gloire qu’il rebaptise demande d’amour (ou de reconnaissance): exister aux yeux des autres alors même que les problèmes de survie sont réglés et les positions de pouvoir réparties. […] Nul humain, du plus privilégié au plus mal loti ne se sent jamais assez reconnu, c’est-à-dire désiré. De sa naissance à sa mort, il vit dans la frustration et le ressentiment. Tant que les us et coutumes de la culture pèsent sur ses affects, il s’inscrit dans la norme névrotique, se contente des menues réjouissances permises tout en condamnant celles auxquelles s’adonnent ses semblables qu’il imagine plus intenses. Les interdits viennent-ils un jour à exploser à la faveur d’une crise sociale, il laisse alors le cours le plus libre à son agressivité primaire trop longtemps refoulée. «Assez joui !», lance-t-il les armes en main à la face de ses frères frustrés. «À mon tour d’en profiter ! Mais vous paierez d’abord pour l’insolent bonheur que vous m’avez volé !». Une guerre ou une révolution offre aux humains d’opportuns prétextes pour régler leurs comptes avec leurs prochains qui abusent du désir d’exister tout en conférant aux élans conjoints de plaisir et de mort qui les animent les couleurs d’une noble cause commune. La foi, le patriotisme, la race, les droits de l’Homme, autant de manières de magnifier les jouissances de l’assassinat, du viol, de la torture, du vol et de la destruction».
In Philosophie sentimentale
Flammarion 2010
Libellés :
éros et civilisation,
grandeur de l'humain
dimanche 11 mars 2012
Nettoyage sémantique (suite)
Même si le négationnisme philosophique qui assiège mon blogue résiste à toute épreuve de lecture de Nietzsche en raison de je ne sais quelle forme de berlue appelée nietzschéisme de gauche, je produis néanmoins ci-dessous le cruel § 34 du Crépuscule des idoles.
« Chrétien et anarchiste. Lorsque l’anarchiste, comme porte-parole des couches sociales dégénérées, réclame dans une belle indignation, le ”droit”, la ”justice”, les ”droits égaux”, il se trouve sous la pression de sa propre inculture qui l’empêche de comprendre pourquoi au fond il souffre — en quoi il est pauvre en vie… Il y a en lui un instinct de causalité qui le pousse à raisonner: il faut que ce soit la faute à quelqu’un s’il vit mal à l’aise… Cette ”belle indignation” lui fait déjà du bien par elle-même, c’est un vrai plaisir pour un pauvre type de pouvoir injurier : il y trouve une petite ivresse de puissance. Déjà la plainte, rien que le fait de se plaindre peut donner à la vie un attrait qui la rend supportable: dans toute plainte il y a une dose raffinée de vengeance, on reproche son malaise, dans certains cas même sa bassesse, comme une injustice, comme un privilège inique, à ceux qui se trouvent dans d’autres conditions. ”Puisque je suis une canaille tu dois en être une aussi”: c’est avec cette logique qu’on fait les révolutions. Les doléances ne valent jamais rien : elles proviennent toujours de la faiblesse. Que l’on attribue son malaise aux autres ou à soi-même — aux autres, le socialiste, à soi-même le chrétien — il n’y a là proprement aucune différence. Dans les deux cas quelqu’un doit être coupable et c’est là ce qu’il y a d’indigne, celui qui souffre prescrit contre sa souffrance le miel de la vengeance. Les objets de ce besoin de vengeance naissent, comme des besoins de plaisir, par des causes occasionnelles: celui qui souffre trouve partout des raisons pour rafraîchir sa haine mesquine […] Le chrétien et l’anarchiste — tous deux sont des dégénérés. — Quand le chrétien condamne, diffame et noircit le monde, il le fait par le même instinct qui pousse l’ouvrier socialiste à condamner à diffamer et à noircir la Société : Le ”Jugement dernier” reste la plus douce consolation de la vengeance, — c’est la révolution telle que l’attend le travailleur socialiste, mais conçue dans des temps quelque peu plus éloignés... L’ ”au-delà” lui-même — à quoi servirait cet au-delà, si ce n’est à salir l’ ”en-deçà” de cette terre ?»
mercredi 29 février 2012
9 SEMAINES AVANT L'ÉLECTION, journal idéal pour une indignation paresseuse et balnéaire
«[…] Ironie, élégance, désenchantement : telles sont les faibles armes qui s’exprimeront ici pour passer le temps, au moins ce temps mauvais de polémiques, de manœuvres, de revirements, de scandales — ces bons scandales qui font toujours bouillir la marmite. Un journal contre les convictions chimériques, contre la politique obligatoire, contre le pain rassis et le jeu électoral. Un journal incrédule, révolté, rêveur, ”insupportablement grave, absolument pas sérieux et irrésistiblement intelligent”».
Frédéric Pajak
Extrait de l’éditorial
de 9 semaines avant l’élection
mardi 28 février 2012
Dès aujourd'hui en kiosque, l'hebdomadaire insondable (clic-clic)
Frédéric Pajak qui lança au début des années 2000 le mensuel L’Imbécile, publie dès ce jour un hebdomadaire très chic mais très mauvais genre que l’on ne trouvera en kiosque, dans les maisons de la presse et en librairie, que durant neuf semaines — d’où son titre : 9 semaines (avant l’élection). Attention ! Mardi prochain, il s’intitulera 8 semaines ; le mardi suivant : 7 semaines, etc.
Présentation :
« Cet hebdomadaire ne connaît qu’une consigne : ne parler ni des candidats ni de leur parti. Indépendant, drôle et intelligent, il s’amuse de tous les sujets, s’enflamme, s’inquiète, réfléchit. Aucune caricature donc, aucune basse polémique, un journal enfin loin de la cacophonie électoraliste et de la complaisance des «communicants».
Pour le prix spécial de 1,50 € au premier numéro, il coûtera ensuite 2,50 € et sera disponible dans tous les kiosques en France du 29 février au 25 avril 2012, et aussi en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.
Douze grandes pages, et en double page centrale : un grand dessin d’humour comme une affiche. Et des romanciers, des essayistes, des philosophes, des dessinateurs… »
Voilà donc un journal éphémère et printanier que les abonnés de ce blogue se feront un plaisir d’acheter en plusieurs exemplaires afin de les offrir autour d’eux.
Libellés :
amitié,
aristocratie de l'esprit
lundi 20 février 2012
Salvador Dalí enculant André Breton
Dans son dernier livre, L’effervescence du vide (Grasset), Nicolas Grimaldi rapporte ce souvenir de Ferdinand Alquié, philosophe ami d'André Breton et compagnon de dérive du mouvement surréaliste.
« Je me rappelle une époque où Breton faisait comparaître Dalí et exigeait de lui une autocritique pour avoir peint une toile qui raillait la Révolution. Dans une plaine sous la lune, il avait peint Lénine à poil, avec un cul comme une meseta où étaient alignés des poteaux électriques. Dalí l’avait intitulée : Le grand programme prolétarien d’électrification. ”De telles peintures, avait dit Breton, cherchent à ridiculiser la Révolution. Vous devez vous en excuser, et à tout le moins vous en expliquer.” Là-dessus, Dalí qui s’en foutait pas mal, de rétorquer à Breton qu’il n’en ferait rien. ”J’avais cru comprendre, lui dit-il, que le surréalisme consistait à laisser l’inconscient prendre possession du réel, comme à laisser nos rêves se peindre sur nos toiles. Je m’interdis de censurer les rêves. Si un jour je rêve que je vous encule, je peindrai une toile de deux mètres Salvador Dalí enculant André Breton.” Breton ne goûtait pas ce genre de plaisanteries. ”Mon cher ami, lui dit-il, je ne saurais trop vous en dissuader.” »
dimanche 19 février 2012
Cours de philosophie du dimanche
Notes prises par Lucie — artiste appliquée et néanmoins rêveuse — lors de mon cours sur la conscience abusée par l’erreur, le mensonge, l’illusion.
A) L’erreur comme défaut de méthode. B) Le mensonge comme art de cacher les faits, le réel (et non la vérité qui en est la vision lucide). C) L’illusion comme l’irrépressible tendance à prendre son désir pour la réalité.
— Remède à l’erreur : reprendre le raisonnement (Descartes).
— Remède au mensonge : le doute et l’exigence de preuves (Descartes).
— Remède à l’illusion : aucun. Aucun qui relève d’une démarche volontaire comme dans les deux cas précédents. Le désir est cause de la tromperie. Impuissance de la raison et de la volonté contre le désir. Exemples : l’illusion amoureuse (Stendhal et la cristallisation), l’illusion religieuse (Lucrèce, Feuerbach, Freud), l’illusion politique (les mêmes auteurs car l’idolâtrie des « grands hommes » résulte d’un identique besoin d’être aimé, sauvé, guidé).
In fine, l’illusion philosophique qui consiste à croire et affirmer que la fin des erreurs, des mensonges, des illusions est possible. Naïveté des Lumières. Outrecuidance des intellectuels. Sottise de leurs suiveurs.
Seule sortie de l’illusion : l’épreuve cruelle du réel. Mais la désillusion ne vaccine pas contre d’autres illusions. Parce qu’il va mourir — seule certitude en sa possession —, l’homme est l’animal crédule.
Bientôt je vérifierai si Lucie a bien suivi.
Libellés :
adolescent,
Jeunes filles,
pédagogie différenciée
mercredi 15 février 2012
Aspect actuel et particulier du " señoritisme" (suite)
Jusqu’à ce que je regarde hier soir l’émission de Frédéric Taddéi, Alain Jugnon était pour moi un señorito de la contestation inconnu au bataillon. En cherchant dans Gougueul, j’ai découvert son sanchopancisme intellectuel à l’égard de Michel Onfray et son néo-debordisme. À ce sujet, voici une notice de présentation de son dernier ouvrage : Le Devenir Debord (Lignes).
« Le Devenir Debord, nous apprend Jugnon, n’est pas un livre de plus sur Debord, mais un livre avec Debord. Devenant Debord. Plus exactement, avec en soi un devenir Debord. Non pas par imitation. La pensée, c’est ce qui ne s’imite pas. Non pas donc pour devenir soi-même Debord après lui. Mais pour que tout devienne un peu de ce que Debord fut et pensa. Le redevienne. Le redevienne au point que lui-même revienne. »
Quelle cause sert un si redoutable libelle ? L’Homme. Car Jugnon part en guerre contre le nihilisme dont la politique sarkozienne est le nom, « nom transitoire d’une politique globale du capital, [qui] tient l’homme pour rien, le réduit à rien, au mieux le ridiculise, au pire le nie ».
C’est bien bon de la part de ce philosophe de vouloir sauver l’Homme, mais pourquoi cela doit-il passer, comme toujours chez les humanistes, par la négation du style ?
lundi 13 février 2012
Souvenir d'un été madrilène
J., ma jeune voisine, est une fervente catholique et une admiratrice de Benoît XVI. L’été dernier, elle alla à Madrid à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse en compagnie de sa petite cousine — dont on lui avait confié la responsabilité. Ne manquant jamais de m’écrire quand elle part en voyage, J. m’adressa au bout de deux jours un courriel qui donne une idée assez précise du genre de réunions qui se déroulent, la nuit, derrière les murs des collèges religieux destinés à accueillir les âmes juvéniles brûlant d’une foi ardente en Jésus Christ et d’un amour sincère pour le pape.
En voici un extrait :
« […] Alberto, l’aumônier, qui venait de foutre mon con, s'arrangea dans mon cul ; il a le vit un peu plus gros que son amant, monseigneur l’évêque de Madrid, mais, toute novice que je suis, Dieu sans doute m'a si bien créée pour ces plaisirs, que je ne souffris point de la différence. J'étais couchée à plat ventre sur sœur Ewa, la mère supérieure, une hommasse moustachue, de manière à ce que mon clitoris posât sur sa bouche, et la friponne, mollement étendue sur des carreaux, le suçait en écartant les cuisses. Entre ses jambes, courbée, ma cousine — vous savez, cher Frédéric, la petite Monica, la cheftaine de louveteaux — lui rendait ce qu'elle me faisait, et le plaisir que la coquine recevait, elle le faisait voluptueusement refluer sur Thomas et Constance, des amis rencontrés plaza de las Cibeles le soir même, qu'elle masturbait de droite et de gauche. Marc, mon copain, et bientôt mon fiancé, derrière ma cousine, se branlait légèrement sur ses fesses, mais sans y pénétrer: l'honneur de l'un et l'autre pucelage de cette petite fille ne regardait absolument que moi. Je tenais un cierge à sa disposition. […]»
Que l’on me croie ou non, ce beau témoignage de J. a ému le cœur du mécréant que je suis.
Libellés :
éros et civilisation
dimanche 12 février 2012
Une pensée de Mademoiselle A.V.R rien que pour moi
Audrey Hepburn, Fred Astaire, Funny face de Stanley Donen...
Une exquise philosophe, flânant chaque jour sur les ondes radiophoniques, me fait parvenir à l'instant cette photographie. J'imagine la mine déconfite de ses fans — dont je suis — et m'en réjouis.
Libellés :
amitié,
homme sentimental,
présence des jolies
jeudi 9 février 2012
Bios théorétikos
Descartes se proposait de “bien juger pour bien faire” ; Wittgenstein, quant à lui, de “bien faire et ne rien dire.” Je me demande si, à ce stade de ma vie et un peu plus réconcilié avec ma médiocrité, la sagesse ne serait pas plutôt pour moi d’observer la maxime inverse — tout aussi inapplicable — : bien dire et ne rien faire.
In Sur le blabla et le chichi des philosophes
P.U.F.
Libellés :
nihilisme de plage,
style et farniente
dimanche 5 février 2012
Dom Gazzara
Dire le jour où l’on prend congé du monde «Voilà une belle journée !» et se laisser conduire vers l'enfer en limousine avec une créature du Diable qui fait semblant de n’avoir jamais trempé ses lèvres dans une coupe de Dom Pérignon. Que demander de plus ?
vendredi 3 février 2012
Femmes anti-bonnes-femmes — 1
Belinda Baggs, la Cyd Charisse du longboard
« Le premier qui a appelé la femme le ”beau sexe” a peut-être voulu faire une plaisanterie, mais il est tombé plus juste qu’il n’a cru le faire lui-même. »
Emmanuel Kant
Libellés :
Biarritz,
flâneuse,
homme sentimental,
présence des jolies
Inscription à :
Articles (Atom)




.jpg)