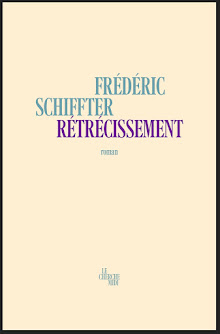J’apprends avec écœurement que la justice américaine vient de refuser la grâce de Troy Davis, un Noir condamné à mort — sans preuve — en 1991 pour le meurtre d'un policier blanc. Aussitôt je pense à la réaction qu’aurait eu le premier philosophe abolitionniste au monde, à savoir Donatien Aldonze François de Sade. « De toutes les lois, la plus affreuse est sans doute celle qui condamne à mort un homme », […] « elle est impraticable, injuste, inadmissible », écrit le Marquis dans Aline et Valcour lorsqu’il était enfermé à la Bastille. Plus tard, avant de connaître les prisons de la République, il déclarera dans sa fameuse Philosophie dans le boudoir que « la raison pour laquelle on doit anéantir la peine de mort, c’est qu’elle n’a jamais réprimé le crime, puisqu’on le commet chaque jour au pied de l’échafaud. On doit supprimer cette peine, en un mot, parce qu’il n’y a point de plus mauvais calcul que celui de faire mourir un homme pour en avoir tué un autre, puisqu’il résulte évidemment de ce procédé qu’au lieu d’un homme de moins, en voilà tout d’un coup deux, et qu’il n’y a que des bourreaux et des imbéciles auxquels une telle arithmétique puisse être familière ». Si je cite ces lignes, c’est pour rappeler que tout l’argumentaire de Camus contre la peine capitale lui est inspiré par Sade et pour dire combien je n’ai toujours pas compris les réticences qu’exprima jadis Elisabeth Badinter à l’égard de cet écrivain sachant que son époux fut sadien dans son combat pour l'abolition de cette barbarie.
mardi 20 septembre 2011
vendredi 9 septembre 2011
Généalogie d'une philosophie sans qualités
Je me rappelle la première fois que je découvris la folie. C’était à l’hôpital psychiatrique de Montpellier, dans les années soixante-sept ou soixante-huit. Son directeur était un vieil ami de mes parents, un « colonial » de Dakar, recasé à ce poste, en métropole, juste après l’indépendance des pays de l’Afrique Occidentale Française. Ce type me faisait penser à l’antipathique docteur Müller de Tintin. Il dirigeait son hôpital en maître autoritaire, bénéficiant d’un immense logement de fonction au cœur d’un beau parc et, aussi, du service d’une domesticité recrutée parmi les malades les plus pauvres, et, donc, les plus dociles. Aimant à montrer son pouvoir et sa réussite, il recevait souvent. Comme ma mère, inexplicablement, l’appréciait et répondait à ses invitations, je passai quelques fois de longs séjours de vacances dans son fief où il régnait sur un peuple d’aliénés discrètement encadré par des silhouettes blanches. Nullement psychiatre mais prétendant, en qualité de patron suprême de l’hôpital, jouer un rôle médical, le docteur Müller était fier de nous faire visiter les lieux où l’on traitait les cas graves. Il nous faisait trotter à travers de longs couloirs éclairés par une suite de grandes fenêtres latérales, jusqu’à ce qu’il ordonnât au planton qui nous précédait — son boy de Dakar qu’il avait gardé à ses ordres — d’ouvrir une porte donnant sur la salle des électrochocs, puis une autre trouée d’un hublot: celle d’une cellule capitonnée. La première, carrelée du sol au plafond, avec en son centre un grand lit en fer équipé de sangles, ne me parut pas effrayante. Il ne me vint pas à l’idée qu’on y électrocutait, méthodiquement, des humains et même des enfants. La seconde, en revanche, me frappa d’horreur. Je ne pus m’empêcher de me voir là, enfermé et entravé par une camisole de force, hurlant ma douleur, des heures et des heures, dans une indifférence matelassée. Ayant deviné mon angoisse, Müller me dit, mi-sérieux, mi-plaisant : « Je peux te jeter là-dedans quand je veux ». Je revois encore la face hilare du nègre et, aussi, celle de ma mère où je crus lire une approbation.
In Le philosophe sans qualités
Libellés :
amour maternel,
bouffée nostalgique
mardi 6 septembre 2011
jeudi 1 septembre 2011
Oyez ! Oyez ! Amis du Gai Savoir !
Je fus attristé quand j’appris, en juin dernier, que Raphaël Enthoven n’animerait plus Les Nouveaux chemins de la connaissance — l’émission matinale de France Culture (de 10H à 11H) destinée à l’honnête homme, espèce rare, et aux femmes anti-bonnes-femmes, espèce plus rare encore.
Les gens qui n’aiment pas Raphaël Enthoven sont des têtes plates de mauvaise foi. Qui est capable, comme lui, lors d'une conversation de quarante-cinq minutes conduite avec courtoisie et clarté en compagnie d'un universitaire ou d'un érudit, de donner à l'auditeur le plaisir de renouer avec le sens le plus maltraité qui soit en cette époque de communication et de prêchi-prêcha : le sens de la subtilité ?
Raphaël Enthoven a pris le large, donc, mais je me réjouis de l’arrivée, à sa place, sur les Nouveaux Chemins, de la très chère Adèle Van Reeth. Étant donnée la maestria avec laquelle elle a animé la nouvelle série d’émissions — consacrée cette semaine au thème de la bêtise —, le meilleur est assuré pour les temps à venir.
P.S. : À propos de philosophie et de bêtise, Adèle Van Reeth proposait aujourd’hui un entretien avec Jean Carnavaggio sur la question des rapports entre un monomaniaque et un naïf célèbres : Don Quichotte et Sancho Panza. Je ne sais pourquoi, cela me remit en mémoire le texte inaugural de mon blogue.
Libellés :
amitié,
conversation,
femmes anti-bonnefemmes
mercredi 31 août 2011
dimanche 14 août 2011
Éros et civilisation — 4
 "Quelle bonne idée de rééditer Sur le Blabla et le Chichi des Philosophes de Frédéric Schiffter. Dommage qu'il ne paraisse que le 5 octobre. J'en aurais offert un exemplaire dédicacé par l'auteur à chacune de mes amies, toutes aussi sexy les unes que le autres, qui aiment Biarritz, qui sont passionnées de surf et tellement séduites par le nihilisme balnéaire..."
"Quelle bonne idée de rééditer Sur le Blabla et le Chichi des Philosophes de Frédéric Schiffter. Dommage qu'il ne paraisse que le 5 octobre. J'en aurais offert un exemplaire dédicacé par l'auteur à chacune de mes amies, toutes aussi sexy les unes que le autres, qui aiment Biarritz, qui sont passionnées de surf et tellement séduites par le nihilisme balnéaire..."
Libellés :
fesses,
nihilisme balnéaire,
pédagogie différenciée,
présence des jolies,
surf
dimanche 7 août 2011
Éros et civilisation — 2
Aux Etats-Unis, des ligues de vertu se sont insurgées contre la publication, par un magazine, de la photographie d’une jeune mère donnant le sein à son enfant. Je partage l’indignation. Il est choquant de montrer ainsi la femme dans une fonction anatomique répandue chez toutes les femelles mammifères. Sans aller jusqu’à approuver l’idée d’une condamnation du journal, je crois en revanche que, pour réparer cette injure faite à la dignité féminine, un tribunal devrait le contraindre à exposer en première page une femme agaçant de sa langue le clitoris d’une autre femme, ou encore embouchant le sexe d’un homme. La truie ou la guenon allaitent elles aussi leurs petits. C’est par la fellation et le cunnilingus que la femme affirme tout l’humain de sa sexualité.
In Traité du Cafard
Libellés :
éros et civilisation,
manières,
séduction
vendredi 5 août 2011
Défense du consommateur
En flânant au milieu des piles de livres de La Maison Darrigade de Biarritz, je tombe sur ce titre : Les écrivains préférés des libraires — "et donc à éviter!", aurait-il fallu ajouter en sous-titre par souci d’honnêteté.
mercredi 3 août 2011
Sauve qui peut (les mots).
Certains jours, je me dis qu’il y a des mots sans défense qu’il faudrait protéger quand on les liquide en douce, et d’autres dont il faudrait laver l’honneur quand on en ternit le sens. Qui « on » ? Les journalistes, bien sûr. De la radio, de la tévé, ceux qui griffonnent dans les gazettes. Tous ces gens tellement chatouilleux sur leur déontologie, parlent et écrivent sans le souci de la précision élémentaire. Écoutez-les, lisez-les. Des professionnels du vague, de l’approximation, du cliché, du raccourci. Rien de plus logique : quand on fait métier d’informer le peuple, on s’exprime comme le peuple. Non pas le peuple tel que de Céline à Alfonse Boudard en passant par Jean Meckert, une littérature en a fait un sujet poétique ou romanesque, mais le peuple réel, c’est-à-dire ces foules de types et de bonnes femmes qui s’engouent pour les messes planétaires du foutebole, la fête de la musique, la réussite ou la déchéance des trèdeurs, la grossesse d’une starlette, la perversion sexuelle supposée d’un dirigeant mondial, le spectacle de milliers de cadavres gisant au sol après un raz-de-marée, l’éruption d’un volcan, une guerre néocoloniale, que sais-je encore — bref, ce peuple qui se goinfre des « infos » ou de l’« actu » en continu jusqu’à atteindre l’obésité mentale et dont le langage se réduit à un lexique de sportif professionnel, d'éducateur spécialisé, de commercial.
Or ce peuple, justement, sait-il encore faire la distinction entre les termes de «populaire » et de « public » ?
« Public » est un mot en sursis. C’était jadis un adjectif utilisé pour désigner une volonté politique d’administrer au sein d’une nation l’instruction, la santé, les transports, le courrier, le crédit et l’énergie. Les services publics, n’étaient pas et ne sont pas des services populaires. Ils évoquent une forme de souveraineté confiée aux citoyens les plus éclairés d’un État — lesquels n’ont cure de plaire au peuple, mais, prioritairement, et quitte à être impopulaires, d’œuvrer pour l’intérêt général. À l’inverse : quand les démagogues s’attaquent aux pouvoirs ou aux services publics, ils le font au nom d’aspirations populaires. Que demande le peuple? La baisse des impôts. La chasse aux Roms. La réduction du nombre de fonctionnaires. Un jour, qui sait, le rétablissement de la peine de mort pour les pédophiles et les tueurs de policiers. Et qu’on ne vienne pas nous objecter que les populistes seraient les faux amis du peuple — victime, quant à lui, selon ses vrais amis, de je ne sais quel « mensonge social ». La vérité est que le peuple fait ami-ami avec n’importe quel parti qu’il laisse parler en son nom pour peu qu’il trouve à traduire son mécontentement du moment — mécontentement faisant toujours suite à un enthousiasme imbécile. Quant au « mensonge social », Georges Darien, l’aristocrate de l’anarchie, dans Le Voleur, en avait dit l’essentiel : «Ses soi-disant victimes savent très bien à quoi s’en tenir et ne l’acceptent comme vérité que par couardise ou intérêt ».
Et puis, quoi ! Le mot « populaire » est laid. Le prononce-t-on en ma présence que, hors de l'oubli où la voix politique relègue aucun contour, se lève, peu ragoûtante, l’idée d’un vil potage. Prenez Michel Homay, par exemple, qui, fâché avec l’école publique, a laissé sa place de pion dans un lycée de bonnes sœurs pour une chaire d’un enseignement supérieur fictif. Qui peut croire que la philosophie en ressort grandie ? Son Université populaire est à la philosophie ce que la soupe du même nom est à la gastronomie.
« Philosophe », voilà un autre mot sali par la novlangue des media. Il n’y eut jamais qu’un seul philosophe, qui n’était ni professeur, ni chercheur, ni auteur de livres : Socrate. Or, qu’est-ce qu’un philosophe pour le peuple ? Un intellectuel qui occupe deux mi-temps. Un mi-temps consacré à enseigner et à publier, un autre mi-temps réservé au journal et au débat télévisés afin d’alerter l’opinion sur une cause morale à défendre, un engagement politique à suivre, ou sur la meilleure manière de vivre une vie d’homme, intérieure et citoyenne. Un communicant en idéologie pour une classe moyenne pauvrement lettrée. Un lampion qui se prend pour une Lumière du siècle. Qu’on lise Platon et Xénophon relatant le procès de Socrate — condamné à mort, je le rappelle, non par un régime tyrannique, mais par une démocratie. Imagine-t-on cet homme s’adresser au peuple sinon pour le bafouer ?
D’aucuns, parmi ceux qui lisent ces lignes, se rappellent peut-être la séquence de ce film, Palombella Rossa, où l'on voit le personnage de Nanni Moretti qui, hors de lui, gifle une petite journaliste inculte lui posant des questions farcies de mots passe-partout et de poncifs branchés: "Mais d'où sortez-vous ces expressions ? Mais comment parlez-vous? Comment parlez-vous? Les mots sont importants! Les mots sont importants!", lui rappelle-t-il en hurlant sa douleur. Ah ! Claquer le beignet à un Giesbert, à un Ruquier, à une Ariane Massenet ! Quel amoureux de la langue réagirait autrement? À moins que le découragement ne l’accable et qu’il se résigne à l’idée que Dieu ne donna le Verbe aux humains que pour les jeter dans le malentendu et la confusion, et que, à présent, les professionnels du verbiage ayant pris le pouvoir, Sa volonté est faite.
vendredi 29 juillet 2011
Les bonnes femmes — 8.
« Quand elles ne savent plus quoi faire, elles se déshabillent, et c'est sans doute ce qu'elles ont de mieux à faire. »
Samuel Beckett
Libellés :
bonnes femmes,
fesses,
manières,
pédagogie différenciée,
présence des jolies
lundi 25 juillet 2011
En écoutant Amy Winehouse, je pense aussi à Sylvia Plath
Quiconque se regarde dans son miroir avec l’attention d’un peintre expressionniste, voit un crâne qui s’essaie à des mimiques sous le masque d’une chair provisoire et comprend qu’avoir forme humaine est en soi une exagération. Il y voit aussi, peut-être, l’image d’un prochain trop proche qui lui sort par les yeux et dont il désire anéantir la présence. Geste difficile, à en croire Sylvia Plath, qui, lassée de cohabiter avec elle-même dans sa « cloche de détresse », aurait aimé se suicider à la manière d’un philosophe romain, en s’ouvrant les veines dans un bain chaud, mais recula devant la glace à pharmacie de sa salle de bain. « Quand il fallut passer à l’acte, écrit-elle, la peau de mes poignets semblait si blanche, si vulnérable, que je ne pus me résoudre à le faire. C’était comme si ce que je voulais tuer ne résidait pas dans cette peau blanche, ou sous le léger pouls bleuté qui palpitait sous mon pouce, mais quelque part ailleurs, plus profondément, plus secrètement, beaucoup plus dur à atteindre. » Que le rasoir n’atteigne pas l’être qu’il faut saigner, voilà qui confirmerait la croyance en l’immatérialité de l’âme, mais ce serait négliger l’efficacité létale du gaz domestique combinée avec l’absorption de barbituriques.
jeudi 21 juillet 2011
No se puede vivir sin amar — 8
« Plus un esprit est revenu de tout, plus il risque, si l'amour le frappe, de réagir en midinette. »
Cioran
Libellés :
bouffée nostalgique,
chanson,
homme sentimental
mardi 19 juillet 2011
Get around !
Chers détracteurs,
Mon précédent article, Blabla à vendre, vous a fait couiner. Vous m’avez écrit des commentaires enragés et, comme souvent, charabiesques. J’en ai laissé passer un ou deux, j’ai censuré les autres.
Quel est mon crime, à vos yeux ? D’être effectivement ce que, ouvertement, je déclare être, à savoir un philosophe sans qualités. Tout se passe comme si je devais démentir ce que j’affirme, faire un effort et correspondre à l’idée que vous vous faites d’un philosophe digne de ce nom — semblable à l’un de ces camelots tel que j’en parodie la posture magistrale dans mon petit récit.
Je ne sers aucun baratin édifiant et lénifiant — ce que vous appelez une éthique —, autant dire que je ne me paye la tête de personne, mais, pour cela même, vous m’en voulez.
Ce que vous désirez, c’est être bluffés et qu’on vous bluffe. Vous cherchez un maître qui vous fasse avancer dans la connaissance de vous-mêmes afin que vous puissiez atteindre à la béatitude, à la connaissance intellectuelle de Dieu, à l’ataraxie, à la surhumanité, aux grandes vertus, turlututu. Comme si vous étiez des individus intéressants à connaître, même à vos propres yeux ! Vous vivez de manière indécente en dessous du seuil de pauvreté intellectuelle. Quelle cible de choix vous faites pour les marchands de sagesse !
Si vous aviez ouvert les Essais de Montaigne vous sauriez que, dès la première page de son œuvre, le bonhomme écrit ceci à l'adresse de son lecteur : "[Dans ce livre], je n'y ai nulle considération de ton service". Autrement dit, en version longue pour les durs de la jugeote : "Lecteur, mon livre ne sert à rien, ni à personne. Il ne t'apprendra ni à vivre, ni à mourir, ni à atteindre le bonheur, etc. Je laisse cela aux habiles doctrinaires qui ont toujours un vaste public de jobards pour les admirer et les croire. Mes essais consistent en une conversation. Un bavardage entre toi et moi. Cela te plaît ? Tant mieux. Cela te défrise ? Tant pis."
Voilà, chers détracteurs, pourquoi vous ne retirerez rien d'utile de mes divagations. Montaigne était mon aïeul. Mon maître en désinvolture.
Et maintenant, dansons sur ce vieux hit !
Salutations balnéaires !
vendredi 15 juillet 2011
samedi 9 juillet 2011
Les bonnes femmes — 7.
« Le lion a ses dents et ses griffes ; l’éléphant et le sanglier ont leurs défenses ; le taureau a ses cornes ; la seiche a son encre qui lui sert à brouiller l’eau autour d’elle. La nature n’a donné à la femme […] que la dissimulation ; cette faculté supplée à la force que l’homme puise dans la vigueur de ses membres et dans sa raison. La dissimulation est innée chez la femme, chez la plus fine, comme chez la plus sotte. […] De cette tare fondamentale, naissent la fausseté, l’infidélité, la trahison, l’ingratitude, etc. Les femmes se parjurent en justice bien plus souvent que les hommes et ce serait une question de savoir si on doit les autoriser à prêter serment. »
Arthur Schopenhauer
Libellés :
bonnes femmes,
chanson,
comédie des passions,
fesses,
homme sentimental
Inscription à :
Articles (Atom)