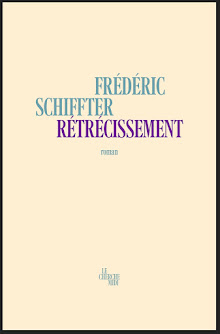Bientôt, les éditions Louise Bottu (clic) publieront Le Voluptueux inquiet — la réponse jusque-là introuvable que Ménécée écrivit à son maître et ami Épicure. Traduit du grec par mes soins, ce texte, découvert il y a quelques années par une équipe d’archéologues sur un site antique proche d'Ankara, exprime un scepticisme de bon aloi à l'égard de la médecine de l'âme — et de son "quadruple remède" — enseignée à l'école du Jardin. Il est évident que l’honnête homme n’y trouvera pas seulement un intérêt philosophique majeur, mais qu'il y goûtera aussi un vif plaisir de l’esprit.
vendredi 31 mai 2019
samedi 20 avril 2019
La retraite est un sport de combat — 2
«Tout le monde désire vivre longtemps, mais personne ne veut être vieux», écrivit Cicéron. «La vieillesse est la punition d’avoir vécu», ajoutera Cioran. Maintenant que je suis à la retraite, je me détourne un peu des philosophes. De toute manière, les exercices spirituels n’ont jamais été mon truc, comme on dit. Je n’écoute plus que Nathalie, mon coach de boxe de salon. Ses maximes — «direct-direct, uppercut-uppercut, crochet-crochet, revers-revers» — répétées deux heures par semaine et auxquelles je me conforme sans réfléchir, me semblent plus sages pour retarder les coups bas du Temps.
mercredi 10 avril 2019
AVIS ! Je donnerai une conférence sur Montaigne à la Médiathèque de Biarritz le samedi 13 avril à 15 h
Montaigne
"Kant a formulé les questions que se posent la plupart des philosophes:
1) Que puis-je savoir ?
2) Que dois-je faire ?
3) Que m’est-il permis d’espérer?
4) Qu’est-ce que l’homme?
Si ces questions sont aussi celles de Montaigne, ses réponses se résument à une seule: rien. C’est donc défigurer Montaigne que d’en faire le précurseur des Lumières. Montaigne est un penseur tragique. La lucidité le retient d’éclairer les hommes."
Montaigne
ou penser dans le désastre
in Philosophie sentimentale
mardi 19 mars 2019
La retraite est un sport de combat
Gabriela Manzoni
Cela fait six mois que je suis à la retraite, comme on dit. Pendant quarante ans je fus payé à ne pas faire grand-chose; désormais, je suis moins bien payé à ne plus rien faire. Pas de grand changement. Si je devais résumer les décennies écoulées, je dirais qu’elles furent placées sous le signe de la nonchalance. La vocation «du loisir et de la culture générale», pour parodier Baudelaire, m’ayant saisi au milieu de l’adolescence, je ne l’ai jamais trahie. Dédaignant toute ambition de carrière, j’ai néanmoins enseigné la philosophie comme le métier l’exige, en mariant la rigueur à la plaisanterie. Et, bien sûr, dans le même temps, je me suis adonné à mon inclination pour la lecture et l’écriture, là encore indolent et pointilleux — considérant que les idées étaient choses trop peu sérieuses pour ne pas les renforcer avec un rien de style. En écrivant ces mots, je me rends compte que ce passe-temps a occupé ma vie et, même, réussi, avec d’autres agréments, à la remplir.
Libellés :
acédie,
adolescent,
style et farniente
lundi 21 janvier 2019
Conférence
Gabriela Manzoni
Que peut-on attendre de la philosophie ? C’est à cette question que nous essaierons de répondre jeudi prochain, le 24 janvier, à 16h15, à la Maison des Associations de Biarritz. Entrée libre.
mercredi 16 janvier 2019
Le samedi 19 janvier à 11h, à la médiathèque de Biarritz, nous donnerons une conférence dont voici le titre: Épicure, les atomes, le vide et le plaisir.
Quand on lui demandait de définir l’être des choses, Épicure répondait: des atomes et du vide. Quand on lui demandait s’il fallait craindre les dieux, il répondait que les dieux ne se souciaient pas des hommes. Quand on lui demandait s’il fallait craindre la mort, il répondait que la mort était une anesthésie radicale. Quand on lui demandait quel était le but de la vie, il répondait: le plaisir. Quand on lui demandait s’il fallait croire au destin, il répondait qu’il convenait de savoir conduire sa vie au cœur du hasard.
L’avantage de la sagesse d’Épicure est de tenir dans une lettre, destinée à son ami Ménécée, lettre que vous, Madame, pouvez glisser dans votre sac-à-main, ou vous, Monsieur, pouvez glisser dans une poche de votre blazer.
mercredi 2 janvier 2019
Barnaba !
Jean-François Barnaba
J’aurais aimé dire à quel point le Gilet Jaune Éric Drouet exerçait sur moi une fascination. Jean-Luc Mélenchon m’a pris de court. L’Insoumis vient de donner la raison pour laquelle ce jeune barbu opère sur lui — comme sur moi — une puissante attraction, à savoir son homonymie avec Jean-Baptiste Drouet, le chef de poste de Varennes qui, en 1791, dénonça à la Garde Nationale le roi Louis XVI en fuite. Porter le patronyme d’un délateur ne peut être que le signe d’une élection. On est appelé par l’Histoire.
Heureusement, le mouvement des Gilets Jaunes ne manque pas de figures fascinantes. Pour ma part, quand je vois Jean-François Barnaba, mon cœur bat. J’en ferais presque une chanson. Un hymne. Je ne parlerai pas de ses discours radicaux qui font trembler le régime. J’évoquerai son génie. Car réussir comme Jean-François Barnaba à ne pas travailler pendant dix ans, tout en touchant de la part de la collectivité un double SMIC, relève d’un sens supérieur de la planque devant quoi je m’incline. Moi qui me pensais doué en ce domaine, j’ai trouvé chez ce rebelle un maître, une idole. S’il constitue une liste électorale en vue des prochaines élections européennes et s’il en prend la direction, il aura mon ardent soutien. Le barnabisme est une idée novatrice en Europe.
mercredi 14 novembre 2018
Pourquoi je suis cartésien
René Descartes
Quand on me demande si je suis cartésien, je réponds par l’affirmative. Non tant parce que je me recommande de l’héritage rationaliste du philosophe, mais parce que je partage l’inclination qui fut longtemps la sienne pour les grasses matinées. Le Père Baillet, son biographe, écrit: «Descartes qui, à son réveil, trouvait toutes les forces de son esprit recueillies, et tous les sens rassis par le repos de la nuit, profitait de ces favorables conjonctures pour méditer. Cette pratique lui tourna tellement en habitude, qu’il s’en fit une manière d’étudier pour toute sa vie; et l’on peut dire que c’est aux matinées de son lit que nous sommes redevables de ce que son esprit a produit de plus important dans la philosophie et dans les mathématiques».
J’ai conscience que les essais que j’ai écrits dans mon lit n’auront pas la même postérité que le Discours de la Méthode ou Les Méditations métaphysiques. Mais, aussi modestes soient-ils, ils viendront témoigner que les grandes idées, contrairement à la vulgate nietzschéenne, ne viennent pas qu’en marchant. Tout cela pour dire que samedi prochain, le 17 novembre, à 15h, à la Médiathèque de Biarritz, je donnerai une conférence sur René Descartes. L’entrée sera libre.
J’ai conscience que les essais que j’ai écrits dans mon lit n’auront pas la même postérité que le Discours de la Méthode ou Les Méditations métaphysiques. Mais, aussi modestes soient-ils, ils viendront témoigner que les grandes idées, contrairement à la vulgate nietzschéenne, ne viennent pas qu’en marchant. Tout cela pour dire que samedi prochain, le 17 novembre, à 15h, à la Médiathèque de Biarritz, je donnerai une conférence sur René Descartes. L’entrée sera libre.
Libellés :
Lire Descartes,
Métaphysique et plumard
dimanche 28 octobre 2018
Pawlikowski, documentariste de l'âme
Parfois, dans l’insignifiance cinématographique, paraît un vrai film qui décrasse nos yeux. Cold War en est un, comme l’était, il y a deux ans, Ida du même Pawel Pawlikowski. J’appelle vrai film une œuvre qui réussit à transposer en images les ombres d’une âme seule. En apparence, sur l’écran, les personnages Wiktor et Zula appartiennent à une société prise dans l’Histoire, vont de part et d’autre du rideau de fer, passent des chants folkloriques au jazz, souffrent les brimades de la bureaucratie soviétique, côtoient la bohême parisienne, tentent l’amour, le trahissent, le vivent jusqu’à son paroxysme, mais en réalité ils émanent tous deux de la nuit intime de Pawlikowski. Ils incarnent les spectres de ses parents qui choisirent de disparaître ensemble avant d’entrer dans le jour blême de la vieillesse. Dès lors, le parti pris du noir et blanc ne répond pas chez Pawlikowski à une vieille habitude de documentariste, à une affectation d’esthète, au désir d’une photogénie de ses acteurs et du décor. La couleur aurait dénaturé les paysages de l’est enneigés et boueux qui furent les états d’âme du cinéaste, comme elle aurait affadi l’évocation de la guerre froide. Le cinéma est un art poétique. Dans sa jeunesse, Pawlikowski consacra une étude à Georg Trakl. À l’évidence, les vers du poète de la solitude suicidaire résonnent encore dans le cœur de l’orphelin. Cold War est un vrai film parce qu’il a été tourné dans la lumière du soleil noir de la mélancolie.
jeudi 18 octobre 2018
Réédition de LA BEAUTÉ, UNE ÉDUCATION ESTHÉTIQUE
Les premières pages:
"Dans Éthique et Infini, Emmanuel Levinas
affirme que si nous nous attardons à détailler les traits d’un prochain, nous
frôlons le meurtre: en contemplant sa physionomie, nous ne lisons pas le «Tu ne
tueras point!» que Dieu, selon lui, aurait inscrit sur la partie la plus nue
de son corps. «La peau du visage est celle qui reste la plus nue […] bien que
d’une nudité décente. Il y a dans le visage une exposition sans défense. Une
pauvreté essentielle… La preuve en est qu’on essaie de masquer cette pauvreté
en se donnant des poses, une contenance.» En ne prenant pas garde à la «nudité»
du visage de l’autre, nous oublions le devoir de nous en rendre responsables. «Lorsque
vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les
décrire […] vous vous tournez vers autrui comme vers un objet.» Aussi, dit
Levinas, quand nous rencontrons quelqu’un, l’unique attitude éthique à tenir à
son égard «est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux».
Le propos
de Levinas est d’une subtilité telle que je ne l’ai jamais lu qu’en ayant le
sentiment d’avoir affaire à une supercherie. N’est-ce pas par le visage que
l’autre me signale d’emblée sa singulière altérité? Qu’est-ce qu’un visage
dépourvu de nez, de front, de menton, d’yeux, sinon celui d’un fantôme, d’une
musulmane recouverte de sa burqa, d’un militant du Ku-Klux-Klan affublé d’une cagoule,
d’un futur pendu dont on a caché la tête sous un sac? Ne pas prêter
attention au visage de quelqu’un, n’en être pas curieux, qu’est-ce d’autre
sinon une marque d’indifférence ou de mépris? Étrange éthique qui exige
que l’on commence par adresser une fin de non-percevoir à la singularité
charnelle de son prochain.
Comment perçoit-on
la «nudité» d’un visage, surtout s’il est un beau visage de femme? Car,
en ce cas, c’est la beauté qui trouble le contemplateur, à tel point que, se
sentant dans ce dénuement qu’on appelle la timidité, le voilà en lutte contre
lui-même pour garder une contenance. C’est pour cette raison même que je ne
donne pas davantage raison à Spinoza quand il déclare que la beauté n’existe
que par la grâce d’un désir: on ne désire pas une femme parce qu’elle est belle,
dit-il, mais une femme est belle parce qu’on la désire. De là, on sait, sourd
la fameuse théorie de la cristallisation — reprise par Stendhal mais que
Spinoza emprunta lui-même à Lucrèce — selon quoi, aiguisée par le désir,
l’imagination en embellit l’objet. Difficile de ne pas entendre-là, dans ce
discours qui réduit la beauté à une hallucination excitée et excitante, l’aveu
d’une détresse sexuelle. Surtout, le propos spinoziste manque son but à mêler
désir et regard. Sur ce point, Kant s’avère d’une plus grande perspicacité que Spinoza.
Pour le solitaire de Königsberg, la question n’est pas de savoir si une femme
est attirante parce qu’elle est belle ou belle parce qu’elle est attirante,
mais de constater qu’une belle femme n’est pas désirable. Dans la mesure où le beau
suscite un plaisir de contemplation, une belle femme relègue un homme à une
distance respectueuse, nécessaire au seul désir qui s’impose en cet instant: le
désir désintéressé — détaché (provisoirement, du moins) d’une finalité sexuelle
— de regarder sa beauté."
mercredi 12 septembre 2018
Lisez-moi, y a qu'ça qui m'intéresse...
Comme j’accepte de bon cœur les éloges qui me sont destinés
— même s’ils sont sincères, comme disait Jules Barbey d’Aurevilly —, voici ceux
de Cyril de la librairie Sauramps de Montpellier.
"Journées
perdues
Journal littéraire d’un «philosophe sans qualités» (comme l’auteur se présente lui-même). Une merveille d’écriture d’un dandysme mordant et éclairé, illuminée par le soleil Basque.
Frédéric Schiffter, bikiniste convaincu et convainquant, nous promène doucement sur les rivages acérés de sa pensée."
Journal littéraire d’un «philosophe sans qualités» (comme l’auteur se présente lui-même). Une merveille d’écriture d’un dandysme mordant et éclairé, illuminée par le soleil Basque.
Frédéric Schiffter, bikiniste convaincu et convainquant, nous promène doucement sur les rivages acérés de sa pensée."
vendredi 31 août 2018
Roland Jaccard, meilleur romancier de la rentrée
Roland Jaccard me confia un jour
qu’il fallut qu’il atteignît l’âge d’homme pour succomber au charme du
style — «parfois tarabiscoté» — d’Henri-Frédéric Amiel. Ce fut son père qui lui fit découvrir le Journal de cet égotiste pétri du
calvinisme genevois et du pessimisme de Schopenhauer, mort en 1881 à 59 ans, inlassable
explorateur de ce «vaste pays» qu’est l’âme humaine. Connaissant Roland
Jaccard, je gage qu’il n’en lut pas les douze tomes. Mais il en dévora
suffisamment de passages pour que naquît en lui une vocation de
diariste — soucieux, quant à lui, d’une écriture sobre et directe inspirée par son ami Cioran.
Ni journal romancé, ni essai, Les derniers jours d’Henri-Frédéric Amiel,
est un roman — le premier, selon moi, de Roland Jaccard — fidèle au titre.
Amiel approche de la soixantaine,
il devine qu’il ne vivra pas au-delà. Depuis quelques années, il se fait
l’effet d’une «momie» qui regarde «la marche du temps». «J’assiste à mon ultime
métamorphose», écrit-il, «je ne sais plus ce que j’étais». Au reste, il ne fut
jamais doué pour être. Il demanda à la vie de «se laisser effleurer par elle
sans la sentir passer», à l’amour «de rester toujours un rêve lointain». Il eût
été heureux si le hasard, qui prend trop souvent des grands airs de Destin, ne
se fût pas ingénié à déranger sa douillette neurasthénie en plaçant trois
jeunes femmes sur son chemin bien tracé qui, de ses études, le mena au professorat. Cécile,
l’adolescente qui poussa le sens du romanesque jusqu’au suicide; Louise, la
petite garce parisienne, d’origine modeste, éprise de revanche sociale — «Les
miséreux ne lâchent rien, note Amiel. Toutes ces œuvres charitables qui
pullulent à Paris ne sont que des laboratoires de lâcheté: on y cultive le
pauvre»—; Marie, enfin, la jeune admiratrice dévote qui sacrifiera son amour
pour respecter le vœu de célibat de son amant et maître.
En lisant ces chapitres sur les
amours ratées d’Amiel, je ne pus m’empêcher de penser à Adolphe le chef-d’œuvre de Benjamin Constant. Même conscience des
impasses du désir et des illusions du cœur. Même brièveté du récit, également.
Roland Jaccard parvient à concentrer en cent trente pages le bilan d’une vie
d’un écrivain qui aura été tout aussi incertain de la qualité de son œuvre que
de la réalité de son existence et auquel il ne prête qu’une satisfaction, celle
d’être enterré au cimetière de Clarens, non loin de la tombe de Nabokov. Tous
deux iront au lever du jour à la chasse aux papillons, les échecs les aideront
à passer le temps. «Je lui parlerai de Cécile, lui de Lolita, espère Amiel. Et quand nous
n’aurons plus rien à nous dire et que personne ne viendra plus fleurir nos
tombes, c’est alors que nous connaîtrons la mort, la vraie mort».
Les derniers jours d’Henri-Frédéric Amiel paraîtront
le 13 septembre. Je ne lirai pas les autres romans de la saison, toujours trop
longs. «Un ouvrage court et bon est deux fois bon», notait Baltasar Gracián.
Puisse la critique se rappeler la remarque du philosophe et reconnaître que Roland
Jaccard sera le meilleur romancier de la rentrée.
mardi 7 août 2018
Inscription à :
Articles (Atom)