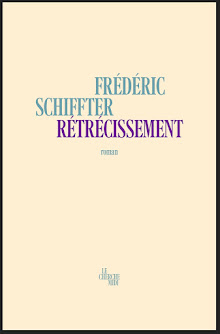Roland Jaccard me confia un jour
qu’il fallut qu’il atteignît l’âge d’homme pour succomber au charme du
style — «parfois tarabiscoté» — d’Henri-Frédéric Amiel. Ce fut son père qui lui fit découvrir le Journal de cet égotiste pétri du
calvinisme genevois et du pessimisme de Schopenhauer, mort en 1881 à 59 ans, inlassable
explorateur de ce «vaste pays» qu’est l’âme humaine. Connaissant Roland
Jaccard, je gage qu’il n’en lut pas les douze tomes. Mais il en dévora
suffisamment de passages pour que naquît en lui une vocation de
diariste — soucieux, quant à lui, d’une écriture sobre et directe inspirée par son ami Cioran.
Ni journal romancé, ni essai, Les derniers jours d’Henri-Frédéric Amiel,
est un roman — le premier, selon moi, de Roland Jaccard — fidèle au titre.
Amiel approche de la soixantaine,
il devine qu’il ne vivra pas au-delà. Depuis quelques années, il se fait
l’effet d’une «momie» qui regarde «la marche du temps». «J’assiste à mon ultime
métamorphose», écrit-il, «je ne sais plus ce que j’étais». Au reste, il ne fut
jamais doué pour être. Il demanda à la vie de «se laisser effleurer par elle
sans la sentir passer», à l’amour «de rester toujours un rêve lointain». Il eût
été heureux si le hasard, qui prend trop souvent des grands airs de Destin, ne
se fût pas ingénié à déranger sa douillette neurasthénie en plaçant trois
jeunes femmes sur son chemin bien tracé qui, de ses études, le mena au professorat. Cécile,
l’adolescente qui poussa le sens du romanesque jusqu’au suicide; Louise, la
petite garce parisienne, d’origine modeste, éprise de revanche sociale — «Les
miséreux ne lâchent rien, note Amiel. Toutes ces œuvres charitables qui
pullulent à Paris ne sont que des laboratoires de lâcheté: on y cultive le
pauvre»—; Marie, enfin, la jeune admiratrice dévote qui sacrifiera son amour
pour respecter le vœu de célibat de son amant et maître.
En lisant ces chapitres sur les
amours ratées d’Amiel, je ne pus m’empêcher de penser à Adolphe le chef-d’œuvre de Benjamin Constant. Même conscience des
impasses du désir et des illusions du cœur. Même brièveté du récit, également.
Roland Jaccard parvient à concentrer en cent trente pages le bilan d’une vie
d’un écrivain qui aura été tout aussi incertain de la qualité de son œuvre que
de la réalité de son existence et auquel il ne prête qu’une satisfaction, celle
d’être enterré au cimetière de Clarens, non loin de la tombe de Nabokov. Tous
deux iront au lever du jour à la chasse aux papillons, les échecs les aideront
à passer le temps. «Je lui parlerai de Cécile, lui de Lolita, espère Amiel. Et quand nous
n’aurons plus rien à nous dire et que personne ne viendra plus fleurir nos
tombes, c’est alors que nous connaîtrons la mort, la vraie mort».
Les derniers jours d’Henri-Frédéric Amiel paraîtront
le 13 septembre. Je ne lirai pas les autres romans de la saison, toujours trop
longs. «Un ouvrage court et bon est deux fois bon», notait Baltasar Gracián.
Puisse la critique se rappeler la remarque du philosophe et reconnaître que Roland
Jaccard sera le meilleur romancier de la rentrée.