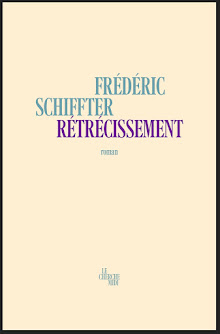Depuis quelque temps, je
travaille à mon nouvel ouvrage: Éthique
de l’étiolement personnel. Pour stimuler ma réflexion, j’ai consulté un opus connu des seuls spécialistes de
l’Idée du Rien, à savoir les Pensées
rancies et cramoisies de l’excellent Johannes Zimmerschmül (clic). En
avançant dans mon étude, j’ai souligné quelques sentences de ce sceptique lypémaniaque
que je souhaite divulguer ici. Ainsi lit-on p.35 que «l’homme du nihil, accablé par
l’odiosité de ses congénères, par les sinistres manigances de son Moi, et par les réalités bétonnés de
l’objet — autrement dit par la
résistance des choses —, a bien du mal à se garder de l’impression que le réel
lui en veut personnellement.[…]»; p.76 qu’«on
ne peut ressentir qu’une pitié immense pour le philosophe, cet avorton au teint
cireux qui s’affaire incessamment à disséquer la réalité empirique. C’est
l’homme qui s’enlise: on ne voit plus que sa main qui s’agite encore pour
implorer un impossible secours et la fange conceptuelle l’ensevelit»; ou,
p.78, cette mésaventure survenue à un Dasein obsédé par la pensée de se
détruire, et qui, pour s’en affranchir, se jeta sur la Méthode pour arriver à la vie bienheureuse de Fichte mais qui, une
fois le livre-remède refermé, fut en proie à des maux épouvantables et dégradants
puis, après une longue agonie, trépassa. Dans le milieu très fermé des hommes
du nihil, le bruit court que Johannes Zimmerschmül ne serait autre que Hermann
Von Trobben, l’auteur du Monocle du
Colonel Sponsz (clic) et qu'il aurait également signé des petits traités d’acédie
inflammatoire sous le nom de Raymond Doppelchor ou de Marcel Banquine. On
aurait affaire à une sorte de nouveau Soren Kierkegaard — penseur dont le
divertissement était, on le sait, de changer de nom pour chaque livre. Sur la
lancée de mes recherches bibliographiques qui contribuent à enrichir le propos
de mon Éthique, je finirai bien par
découvrir ce moraliste au «radical quinquet».
jeudi 28 décembre 2017
dimanche 17 décembre 2017
Otium cum litteris — IX
En date du 8 novembre 1806, quelques
mois après le suicide de son père, le jeune Arthur Schopenhauer, âgé de
dix-sept ans, écrit à sa mère Johanna une brève missive: «L’oubli d’un désespoir passé est un trait si étrange de la nature humaine
qu’on ne le croirait pas si on ne le constatait pas. Tieck l’a magnifiquement
exprimé par ces mots: ”Nous voilà à gémir et à demander aux étoiles: Qui
n’a jamais été plus malheureux que nous?, alors que derrière nous se profile
déjà l’avenir moqueur qui se rit de la douleur éphémère de l’homme.” Et il en est toujours certainement ainsi.
Rien n’est fixe dans la vie éphémère, ni douleur infinie, ni joie éternelle, ni
impression permanente, ni enthousiasme durable, ni décision importante qui
tiendrait pour la vie. Tout se dissout dans le flux du temps. Les minutes, les
innombrables atomes microscopiques dans lesquels toute action déchoit, sont les
vers rongeurs qui dévastent tout ce qu’il y a de grand et de hardi. Le monstre
de la quotidienneté écrase tout ce qui aspire à s’élever. On ne prend rien au
sérieux dans la vie humaine parce que la poussière n’en vaut pas la peine.
Pourquoi des passions dureraient-elles éternellement pour ces misères ?
Life is a
jest and all things show it
I thought so once and now I know it.
John
Gay »
Inspiré par le deuil, ce
texte contient en germe la pensée tragique du philosophe et, déjà, l’élégance
de son style s’y dessine. Douze ans plus tard, après avoir rédigé De la vision et des couleurs et De la quadruple racine du principe de raison
suffisante, il achève la première partie de son opus magnum: Le Monde comme
volonté et comme représentation. Schopenhauer a trente ans. Il ne doute pas
de son génie et n’a que mépris pour les post-kantiens de son temps tels Hegel
et Fichte. En 1850 Le Monde n’a
toujours pas trouvé ses lecteurs et son éditeur s’en plaint. «Ce n’est pas
un reproche à adresser à mes livres, lui écrit-il, mais au public.»
Infatigable, il traduit en allemand David Hume et Baltasar Gracián et envisage
de publier à Londres une version anglaise des trois Critiques de Kant. Le public finit par découvrir Schopenhauer au
soir de sa vie notamment à travers les Parerga
et Paralipomena (Oublis et Ajouts) qu’il appelle ses «petits écrits». Mais
ce sont des écrivains européens comme Maupassant, Ibsen, Zola, Huysmans, puis
Proust, Mann, et d’autres, qui enschopenhaueriseront pour le meilleur, jamais
pour le pire, leur propre œuvre.
Pourquoi évoqué-je le Patron, comme l’appelait
Cioran? Ayant acheté les deux volumes de sa correspondance(clic) courant des années
1803 à 1860 (l’année de sa mort) et lisant chaque jour une dizaine de lettres je parfais ma connaissance de l’homme qui tenait
pour lui qu’une philosophie n’était qu’une biographie plus ou moins bien fardée
et, par là, une pathographie.
mardi 12 décembre 2017
Otium cum litteris — VIII
Depuis longtemps je
concevais le projet d’écrire un essai qui se serait intitulé Tintin et le Néant. À cette fin, j’avais
jeté des notes dans un carnet. Frappé, peut-être, par cette langueur qui
affecte les savants de l’expédition Sanders-Hardmuth relatée dans Les Sept boules de cristal, mon essai resta en l’état. Or voilà
que, la semaine dernière, en prenant un verre avec les amis Guillermo, Djiad et
l’Infâme R.J., ce dernier sortit du petit sac en papier où il range ses
biscuits suisses un mince opuscule de facture soignée. «Lequel parmi vous,
demanda-t-il, peut se prévaloir d’une connaissance érudite des albums de
Tintin?» Guillermo et Djiad, férus de Cioran et de Beckett, eurent l’honnêteté de confesser leurs lacunes en la matière. J’en revendiquai quant
à moi l’entière maîtrise. C’est donc tout naturellement que Roland m’offrit Le Monocle du colonel Sponsz (Bookéditions)— avouant
au passage que, lui aussi, manquait des références requises.
Le soir même, en lisant
l’ouvrage, je songeai que l’auteur, Hermann von Trobben, avait écrit à ma place
l’essai indépassable sur l’idée du rien dans les aventures de Tintin. J’en
éprouvai un sentiment mélangé de plaisir intellectuel et de jalousie. Toutes
mes intuitions au sujet du rapport au monde hanté par le Nihil que vivent les personnages
clés ou secondaires d’Hergé prenaient forme sous la plume du mystérieux exégète
germanique. Je reproduis ici quelques passages du Monocle du colonel Sponsz:
« Différence de moyens — Comme Rascar Capac dans le cauchemar de
Tintin, l’homme du nihil est un “mort
vivant“. Mais quand le prince inca lance de relativement inoffensives boules de
cristal sur le vulgum pecus, l’homme
du nihil, lui, se sert d’aphorismes hyper-acides et contondants qu’il
projette sur l’omnitude pour la concasser et en faire “la forme apologétique du
suicide compulsif.“»
«Zouaverie philosophique: Lorsque le professeur Tournesol, courroucé
au-delà de toute expression, entraîne le capitaine Haddock à travers le centre
spatial de Sbrodj (cf. Objectif Lune) et, lui désignant un groupe de
philosophes occupés à extruder des concepts, s’exclame: “Et ces gens-là, ils
font les zouaves sans doute?“, il ne croit pas si bien dire. Car ces “amis de
la sagesse“, comme tous ceux qui les ont précédés, s’escriment en vain à disséquer
la réalité empirique: tout ce qu’ils parviennent à produire, c’est de la
“catalepsie conceptuelle“. Autrement dit, sous couvert d’idéalisme, de
nominalisme ou d’empirisme logique, ils “font les zouaves“.»
« Dans la littérature,
on trouve peu de descriptions aussi véridiques et saisissantes du réel que celle que fait le capitaine
Haddock dans Le Temple du soleil: "Pays de sauvages, mille sabords !… Des montagnes, toujours des montagnes
et des tas de sales animaux !…" Même Schopenhauer n’eût pas dit
mieux. »
« Clin d’œil d’Hergé à Otto Weininger — Madame Boullu est cette
mégère, épouse de l’exaspérant marbrier des Bijoux
de la Castafiore, qui, recevant les appels téléphoniques du capitaine
Haddock, lui répond régulièrement que son mari est en déplacement alors qu’il
se trouve en réalité à ses côtés. Dans l’univers de Tintin, elle représente l’éternel féminin, avec son terrible
cortège de duplicité, d’absence d’âme et de sottise satisfaite d’elle-même.
Honte! Honte à toi, femme Boullu !»
Etc.
À mesure que je tournais les
pages de cette pénétrante étude, il m’apparut évident que, contrairement à ce
que je pensais jadis, le stoïcisme, le taoïsme, les philosophies de
l’existence, la psychanalyse, etc., ne trouvaient pas un simple écho dans
l’œuvre d’Hergé, mais l’avaient annoncée et avaient trouvé en elle leur parachèvement
nihiliste. Le lecteur attentif demandera pourquoi le colonel Sponsz demeure le seul personnage dont l’eccéité n’est pas traitée et le
signifiant propre non-dit. Telle est la politesse de Hermann von Trobben de
laisser la pensée dans l’Ouvert de l’interrogation.
samedi 2 décembre 2017
Inscription à :
Articles (Atom)